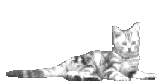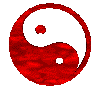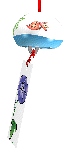Dans l’inventaire de la succession de la monarchie de Juillet, la part de l’héritage asiatique était mince alors que Guizot avait proclamé
« qu’il ne convenait pas que la France soit absente d’une aussi vaste partie du monde ».
Quelque peu à la remorque de l’Angleterre, la France de Louis-Philippe n’en avait pas moins signé avec la Chine le traité de Whampoa en octobre 1844, obtenu une concession à Shanghai et la reconnaissance de sa protection des missions catholiques.

Prise de la citadelle de Saïgon par l'expédition franco-espagnole, sous le commandement de l'amiral Rigault de Genouilly, le 17 février 1859.
Dessin issu du journal L'Illustration, dans l'édition du 23 avril 1859.

C’eût été une bonne base pour étendre son influence à travers l’Extrême-Orient…
si elle avait eu une politique asiatique cohérente et, un tant soit peu, le génie du commerce.
A l’avènement du second Empire, la présence française en Asie orientale se réduisait à notre escadre des mers de Chine, aux missions catholiques, à quelques diplomates itinérants et à une poignée de négociants-aventuriers.
Nos évêques in partibus avaient la réputation justifiée de provoquer trop d’incidents avec les autorités locales, nos officiers de marine étaient obsédés par la question de leurs « stations navales » des mers du Sud, et les diplomates de passage accumulaient les bévues.
Il va sans dire que les uns et les autres s’opposaient en d’interminables querelles sur leurs priorités ou leurs prérogatives.
Or en 1852, la situation des missionnaires catholiques et de leurs ouailles suscitait de légitimes inquiétudes, notamment en Annam où les mandarins faisaient tomber les têtes. En juillet, Mgr Forcade, vicaire apostolique au Japon et sept autres évêques de Chine « et pays adjacents », s’en étaient ouverts dans une lettre au nouveau Prince-président des Français pour préconiser une démonstration navale conduite par « un capitaine prudent et énergique » qu’ils souhaitaient être Rigault de Genouilly.
Leur requête resta sans réponse et sans suite, le destinataire ayant d’autres idées en tête. Napoléon III, qui avait une formation cosmopolite, pensait et réagissait en chef d’Etat européen en avance sur son temps, dépourvu d’esprit de conquête, avec une vision floue de l’unité européenne par l’industrialisation et le progrès.
Les mondes asiatiques ne le fascinaient pas et lui inspiraient une sorte de crainte. Aussi s’efforcera-t-il, au moins pendant quelques années, de ne pas se laisser entraîner « trop loin » vers l’Est par ceux qui associaient « l’honneur de la France et l’intérêt de nos missions ».
Mais les manipulations de l’opinion, les forces de pression et l’entourage eurent le dernier mot. Les représentants des missions mobilisaient l’indignation des fidèles contre les persécutions religieuses en Asie et se prononçaient pour qu’une « bonne leçon » soit infligée à ces pays barbares qui s’opposaient à la propagation de la foi.
Exploitées par la presse française, leurs « informations » touchaient l’opinion publique qui était amenée à souhaiter une intervention musclée « pour venger le sang français répandu par des chétifs et insolents barbares ».
A la fin de 1852, Napoléon III jugea politique de lâcher du lest et annonça son intention de demander raison à la cour d’Annam. Mais en 1854 l’attention se déplaça vers la guerre de Crimée.
En 1856, les affaires extrême-orientales ressortirent des cartons du gouvernement. Charles de Montigny, notre époustouflant consul à Shanghai, reçut mission de nouer de nouveaux liens et de signer des traités avec le Siam, le Cambodge et l’Annam.
Ses maladresses et son piteux échec ridiculisèrent la diplomatie française… et relancèrent les persécutions en Annam. Trois mois après ce fiasco, Mgr Pellerin, vicaire apostolique en Cochinchine, se présenta aux Tuileries où en fervente catholique l’impératrice Eugénie lui avait préparé la voie.
Napoléon III prêta l’oreille à son discours, et en juillet 1857 décida seul d’une action navale qui devrait faire réfléchir la cour d’Annam dont l’hostilité aux missions ne désarmait pas.
L’escadre française entra dans la baie de Tourane le 30 août 1858, et débarqua 1 500 soldats de marine renforcés par un millier de Tagals philippins.
Pendant 19 mois ils allaient rester bloqués dans un camp retranché où les fièvres et le choléra faisaient des coupes sombres… avant d’être repliés sur Saigon occupé par une petite garnison française depuis fevrier 1859.
Quelques mois plus tôt, Rigault de Genouilly avait écrit à son ministre que
« les intéressés ( ?) ont voulu engager le gouvernement sachant qu’une fois engagé, il lui serait difficile, sinon impossible de reculer ».
L’amiral voyait juste.
Mais le 29 avril 1859 Napoléon III avait déclaré la guerre à l’Autriche et était parti pour l’armée en laissant la régence à l’Impératrice…
Les « intéressés » incriminés étaient connus. Il s’agissait en premier lieu des évêques, Mgr Pellerin et autres, qui par leurs sornettes avaient circonvenu l’Impératrice et trompé l’Empereur…
Les amiraux qui les avaient vus à l’œuvre les accusaient d’être les principaux responsables de l’impasse où l’on se trouvait. Mais la marine prenait l’affaire en main… et sans ménagement avait mis fin aux prétentions des missions à diriger les opérations militaires en fonction de leurs intérêts.
En leur rappelant que le commandant était le seul maître à bord... Le 24 février 1861, l’amiral Charner donna l’assaut aux retranchements annamites devant Saigon et sur sa lancée occupa les deux provinces voisines. En décembre son successeur l’amiral Bonard leur en ajouta une troisième et en 1862 fit reconnaître leur annexion par la cour d’Annam.
Napoléon III semblait résigné au fait accompli de conquêtes lointaines qui lui paraissaient inutiles.
A l’ouverture de la session législative de 1863, il crut bon de préciser que
« notre établissement en Cochinchine n’avait pas été l’exécution d’un plan prémédité mais avait été amené par les circonstances ».
Ce qui, en échange d’un vague protectorat, ne l’avait pas empêché de souscrire à un projet de traité portant rétrocession à l’Annam desdites provinces, à l’exception de Saigon.
Projet qui bien entendu ne fut pas suivi d’effet.
Il était évident que Napoléon III avait de facto renoncé à imposer ses vues à des amiraux-proconsuls n’en faisant qu’à leur tête.
Mais leurs décisions, même les plus saugrenues, ne manquaient pas de se référer à Sa Majesté l’Empereur des Français et avaient le plus souvent l’aval de leur ministre, le marquis de Chasseloup-Laubat.
Cette délégation informelle du pouvoir impérial était souvent source de surprises et d’agacement. Par exemple quand
l’amiral de La Grandière envoya aux Tuileries
un traité de protectorat paraphé par lui-même et le roi du Cambodge
le 11 août 1863 et qui commençait par :
« S.M. l’Empereur des Français reconnaissant la souveraineté
du roi du Cambodge Prea Norodom…
s’engage à maintenir dans ses États l’ordre et la tranquillité, à la protéger contre toute attaque extérieure, à l’aider dans la perception des droits de commerce », etc.
Napoléon III s’était un peu fait tirer pour ratifier ce traité l’impliquant un peu plus dans les imbroglios asiatiques.
Mais notre établissement indochinois s’organisait et s’étendait sans son approbation ni son opposition. Quand, le 20 juin 1867,
La Grandière occupera trois autres provinces de Cochinchine
« au nom de l’Empereur », ce dernier apprenant la nouvelle ne fera plus
qu’en exprimer ses « regrets ».
L’impératrice Eugénie, instigatrice de l’intervention en Cochinchine, avait reporté son intérêt passionné sur le Mexique et entraîné Napoléon III dans une folle expédition militaire.
Elle se souviendra pourtant de cette terre d’Asie devenue française
« grâce à elle »
quand, en exil à Chislehurst en 1870 et déchue de ses pouvoirs, elle chargea le fils de Théophile Gautier de proposer à Bismarck de renoncer à l’Alsace-Lorraine en échange… de la Cochinchine !
Article de Charles Meyer, spécialiste de l’Asie, notamment auteur d’une Histoire de la femme chinoise (Lattès, 1986).
Cet article est paru dans le numéro spécial 37 de la revue Historia.