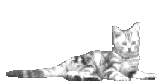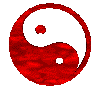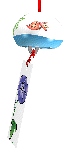-

Tibet
Depuis l’occupation du Tibet par l’armée chinoise en 1950, la population a vécu une répression féroce.
Emprisonnés, exilés, affamés ou torturés, les tibétains ont subi un véritable génocide culturel.Le dalaï-lama, exilé en Inde depuis 1959, continue à parcourir le monde pour que le Tibet ne soit pas une nation opprimée oubliée de tous.
Communément appelé le « toit du monde, le Tibet est aujourd’hui une région qui a reçu le statut de région autonome.
Mais sous cette appellation flatteuse, la population subit une sinisation (installation massive de Chinois à l’intérieur du Tibet ; rééducation des moines tibétains ; enseignement en langue chinoise) toujours plus pressante.

-
MA TENTATIVE D’EVASION ET SES CONSEQUENCES
Nous quittâmes le camp vers 23 heures sans être inquiétés. Une demi-heure plus tard, nous voguions déjà bon train en direction de VinhThuy. La lune masquée par de lourds nuages noirs chargés de pluie diffusait une clarté complice. C’était le temps idéal. Le camp était déjà loin. Nous éprouvions, l’un et l’autre, une sensation de soulagement de l’avoir enfin quitté, bien que le 14 juillet de cette année terrible 1953 se fût déroulé sous de bons auspices.
Je dois en effet avouer que pour commémorer ce jour anniversaire de la liberté, les responsables du Camp 113 avaient fait un effort, qui pour les non-initiés en matière d’ordinaire avait pu paraître louable. En fait, nous n’avions récupéré qu’une infime partie de l’excédent de boni réalisé sur les morts, dont les décès n’étaient déclarés officiellement, en haut lieu, qu’avec dix ou quinze jours de retard. Toutefois, la ration de riz avait été sensiblement augmentée. La part de viande de buffle doublée. Le saindoux, débloqué pour l’occasion et prélevé sur les cochons dont nos geôliers s’étaient goinfrés, m’avait permis de rôtir la viande et même d’arroser le riz avant distribution. Des courges avaient complété le menu.
Quel événement ! Depuis trois semaines nous n’avions pas goûté aux légumes. Pour une fois depuis neuf mois, j’avais eu l’impression d’avoir mangé à ma faim. Mon estomac aussi paraissait satisfait.

La nuit était calme ; seul, le croassement des crapauds-buffles, de part et d’autre des rives, troublait le silence de la jungle. Mais l’atmosphère était lourde et orageuse.
Sur notre petite rivière la navigation était un jeu d’enfant, un coup de pagaie de temps à autre suffisait pour maintenir notre radeau bien au milieu, et dans le sens du courant.

Sans montre (8), nous n’avions qu’une très vague notion de l’heure. Bientôt parvint à nos oreilles un grondement sourd et continu, léger d’abord, mais qui alla s’amplifiant au fur et à mesure que nous avancions. A n’en pas douter, nous approchions très vite de la Rivière Claire, car c’était bien elle qui faisait tout ce vacarme. Gonflée par les pluies diluviennes et incessantes des derniers jours, elle était vraisemblablement à son plus haut niveau. A l’idée d’affronter avec notre frêle esquif cet immense torrent, j’éprouvai quelques craintes.
L’apparition soudaine de la silhouette disloquée du pont de VinhThuy confirma nos prévisions : l’impétueuse Rivière Claire se trouvait immédiatement derrière. Combien de fois avais-je franchi ce pont branlant, dépourvu de garde-fou, dont le tablier métallique effondré sur plus de la moitié de sa longueur était remplacé par un tablier de bambou, lui-même suspendu par des lianes aux anciens câbles d’acier de soutènement demeurés intacts ? Dix fois, quinze fois peut-être ; je dois avouer qu’à chaque passage j’étais pris de vertige.
Le village de Vinh-Thuy s’élevait à notre gauche. Par trois fois nous tentâmes de franchir la barre qui se formait entre la Rivière Claire et son petit affluent.

Par trois fois nous fûmes refoulés, et notre radeau en souffrit énormément. C’est pourquoi, sagement, nous nous approchâmes de la rive droite pour faire halte dans une petite crique afin de souffler et réfléchir sur les dispositions à prendre.
La découverte, dans ce petit havre, d’une flottille de cinq magnifiques et solides pirogues d’un seul tenant facilita nos réflexions sur la conduite à tenir. Leur présence près du village, en lieu et place des radeaux traditionnels, indiquait clairement que ce type d’embarcation était utilisé de préférence à tout autre par les indigènes de l’endroit en raison de sa solidité et de sa maniabilité. De là à faire l’échange, il n’y avait qu’un pas, vite franchi.
Ce fut donc en pirogue que nous repartîmes, mais en longeant, cette fois, au plus près la rive droite. Cette initiative nous permit d’entrer sans trop de difficultés dans la Rivière Claire, qui aussitôt nous entraîna à une vitesse folle vers la liberté. Nous eûmes cependant toutes les peines du monde à atteindre son milieu, où le courant était encore plus rapide, puis à maintenir notre embarcation dans le sens du courant pour éviter qu’elle ne chavire.
Vers les deux heures du matin, la pluie se mit à tomber dru, nous forçant très vite à écoper pour ne pas trop nous enfoncera Il y avait heureusement à bord le nécessaire, deux fonds de bambou creux. En fin de nuit, la visibilité devint presque nulle ; la pluie redoubla de violence, le vent se mit de la partie. Notre pirogue roulait et tanguait sans cesse. Bientôt, poussée par je ne sais quelle force, elle se mit en travers, et ce fut presque aussitôt la catastrophe. Notre embarcation heurta un rocher à fleur d’eau. Le temps de crier à Montagne "direction rive gauche" et nous étions précipités aines, qui nous entraînèrent vite et loin, toujours plus loin, dans les flots déchaînés, malgré nos efforts pour pousser vers la gauche. Très vite, je perdis de vue mon camarade. Happé moi-même par un remous, je disparus brusquement sous l’eau, entraîné par une force invisible. A partir de cet instant, tout se passa rapidement. Aveuglé, pris de panique, je bus la tasse, incapable de m’arracher à l’attraction de cette vague de fond. En même temps que je sentais mes forces m’abandonner m’apparurent les images des êtres chers dont j’étais l’unique soutien. Tout de suite l’instinct de conservation reprit le dessus, et dans un ultime sursaut de volonté et d’énergie je remontai à la surface. Il me fallut encore plus d’un quart d’heure d’efforts pour atteindre la rive. Pour comble de malchance, j’atterris dans un buisson d’épineux. A bout de force, je n’allai pas plus loin et m’accrochai désespérément à ces branches salvatrices, dont les épines pourtant s’enfonçaient dans ma chair. Après un dernier effort et quelques piqûres supplémentaires je parvins enfin à me hisser sur la berge, où je m’affalai dans l’herbe humide.
Qu’était devenu mon compagnon ? Moins bon nageur, il avait dû être emporté beaucoup plus loin. C’était donc en aval que je devais le rechercher.
Le jour commençait à poindre. Précautionneusement, je descendis le long de la berge, me dissimulant de mon mieux aux regards éventuels d’indiscrets et m’arrêtant de temps en temps pour écouter. Par intermittence, j’émettais un sifflement bref pour signaler ma présence. Au bout d’un quart d’heure de marche, je reçus, comme en écho, le même sifflement bref. Ce ne pouvait être que Montagne, il n’y avait que les français pour siffler de la sorte. Au détour de la piste, nous tombions dans les bras l’un de l’autre, heureux de nous retrouver sains et saufs après nos malheurs.
Que d’émotions et de forces déjà gaspillées, depuis notre départ, pour rien ! De plus, dans le naufrage, nous avions tout perdu : boules de riz de réserve, coupe-coupe, comprimés, chapeau tonkinois, précieux accessoire pour dissimuler nos cheveux et visages. Malgré tous ces avatars, nous prîmes la sage précaution de nous reposer. Rompus de fatigue, nous nous endormîmes très vite.
A notre réveil, le soleil avait amorcé sa courbe descendante. Nous avions dû dormir près de six heures. La remise sur pied fut pénible, nous étions courbaturés, mais nous avions également faim. Soulager cette faim fut notre première préoccupation. Marchant le long de la rive, dans le sens du courant, nous allâmes à la recherche de notre pitance. Enfin, nous dénichâmes un petit carré de manioc. Pendant que je déterrais les racines, Montagne faisait le guet, car nous n’étions certainement pas très éloignés d’un village ou d’une habitation isolée de paysan ou de pêcheur. Continuant à longer la rivière, nous aperçûmes bientôt le village en question : cinq ou six cagnas groupées, disposées à flanc de coteau à 500 mètres à peine de la rive où nous nous trouvions. Redoublant de vigilance, nous poursuivîmes notre marche et découvrîmes, dans un renfoncement, trois radeaux d’apparence très solide. Vivres et embarcation étant trouvés, il ne nous restait plus qu’à attendre la tombée de la nuit pour repartir. Camouflés dans un fourré, d’où nous pouvions sans être vus surveiller les allées et venues des indigènes du coin, nous nous mîmes à grignoter nos racines de manioc.
A l’inverse de la première nuit, la seconde s’écoula sans incident ni accident. La prise de possession de notre nouvelle embarcation fut un jeu d’enfant. Compte tenu de la vitesse du courant, nous avions dû parcourir près de 70 km, soit quelque 20 de plus que la première nuit, qui fut courte. Après le sommeil réparateur du matin, nous partîmes comme la veille à la recherche de notre nourriture. Epis de maïs encore verts, ananas, citrons sauvages constituèrent notre menu du jour, et même une réserve pour le lendemain, tant la récolte avait été bonne.
Au crépuscule, nous repartîmes pour la troisième nuit. Vers une heure, les ennuis commencèrent. A deux kilomètres en aval, sur la rive gauche, quelques points lumineux apparurent. Il s’agissait d’une dizaine d’hommes et de femmes affairés autour d’un sampan. Avions-nous été repérés? Etait-ce un barrage? Autant de questions restant sans réponse. Nous n’étions pas à la noce. Par mesure de prudence, nous obliquâmes vers la rive opposée, où rien d’anormal ne se révélait à cet instant. A l’endroit où nous .étions, la Rivière Claire s’étalait déjà sur une largeur de près de cent mètres ; par ailleurs, la nuit était très sombre. Dans ces conditions, comme les torches ne portaient pas à plus de 50 mètres, il devait être difficile de nous voir. Longeant la berge à la toucher, le coeur battant, nous franchîmes sans encombre ce point délicat. Nous avions eu très chaud.
Tard dans la nuit, nous fumes stoppés par deux barrages successifs que nous dûmes contourner, l’un par la droite, l’autre par la gauche, en montant sur les rives pour les franchir. La présence de ces barrages, qui ralentissaient considérablement la vitesse du courant, était significative : nous approchions de Tuyen-Quang, petite ville dont j’appréhendais la traversée. Navigant toujours au milieu de la rivière pour profiter au mieux du courant, nous nous trouvâmes à un certain moment face à une grosse masse sombre qui nous barrait le chemin. Ce ne fut que lorsqu’on y accosta que nous nous aperçûmes qu’il s’agissait d’un grand îlot broussailleux, qui en cet endroit séparait le cours d’eau en deux tronçons. Nous optâmes pour celui de droite, le plus large.
Nous étions dans Tuyen-Quang. Déjà, sur la rive droite, on apercevait les profils d’habitations sur un ciel très sombre, annonciateur de pluie. Plus près de nous, le long de la berge, amarrées les unes aux autres, s’étalaient des barques de pêcheurs surmontées d’une cabine rudimentaire dans laquelle, pêle-mêle s’entassaient famille et animaux domestiques. Nous n’avancions plus que très lentement, les sens en éveil constant. Brusquement, la pluie se mit à tomber, diminuant encore la visibilité mais augmentant, par la même occasion, nos chances de ne pas être entendus. Mais il était malheureusement dit que nous ne devions pas passer inaperçus. Soudain, dans l’une des embarcations, un roquet se manifesta, imité bientôt par d’autres. Ah, les maudits cabots ! Ils allaient réveiller tout le monde. Des voix s’élevèrent. Par précaution, nous nous laissâmes glisser dans l’eau pour nous dissimuler à la vue d’éventuels soupçonneux. Cramponnés d’une main au radeau, nageant de l’autre, nous nous efforcions de mettre le plus d’espace possible entre les barques et nous. Au bout de quelques minutes les chiens s’apaisèrent, les voix se turent. Par crainte de récidive, nous restâmes encore quelques instants dans notre position inconfortable d’immergés.
Mais déjà l’aube s’annonçait, il était plus que temps de rechercher le couvert protecteur pour la journée. Mais où trouver ce couvert ? Nous étions en pleine ville, et dans une ville que nous ne connaissions pas: donc, dans une situation critique. Arrivée à l’extrême pointe de l’îlot découvert à notre arrivée, nous le contournâmes pour remonter d’une centaine de mètres le bras de rivière que nous avions auparavant négligé. Nous avions été bien inspirés : à cet endroit, la rive était plantée d’arbres à feuillage épais, dont les plus basses branches formaient au-dessus de l’eau une voûte protectrice sous laquelle nous nous engageâmes. Radeau amarré, nous grimpâmes sur la berge haute de 5 à 6 mètres. Sur ce talus assez large - car c’était bien un talus, recouvert d’une végétation très dense - nous découvrîmes, face à nous en contrebas, un immense jardin d’agrément, avec, pour toile de fond, une belle demeure résidentielle, ancienne habitation d’administrateur ou de riche colon.
Bien que ce ne fut pas l’endroit rêvé pour se camoufler, nous dûmes nous en contenter, car nous étions en pleine ville. Pour éviter toute surprise, un tour de garde fut instauré. Au cours de la journée, nous eûmes l’occasion d’assister aux allées et venues des habitants du domaine, qui étaient certainement loin de se douter que le talus de leur jardin servait ce jour-là de refuge à deux prisonniers évadés d’un de leurs camps modèles.
Il faisait nuit depuis une heure environ. Dans la ville, comme sur la rivière, toute activité avait cessé. Par mesure de prudence, nous avions néanmoins retardé notre départ et attendu que toutes les lumières se soient éteintes.
Nous en étions à notre quatrième nuit de navigation. Une demi-heure après avoir quitté notre talus, Tuyen-Quang n’était plus qu’un mauvais souvenir. Nous filions à nouveau de toute la force de nos maigres bras vers Vietri, distante encore, d’après mes calculs, de 130 à 150 km. Allions-nous avoir la force d’y parvenir ? A certains moments, il m’arrivait d’en douter; car au fil des jours notre capacité de résistance s’amenuisait. A la fatigue physique et nerveuse progressive s’ajouta, cette nuit-là, une chiasse carabines provoquée par le mais, légumes et fruits verts consommés crus. Elle n’avait rien de comparable avec la dysenterie chronique habituelle du prisonnier, à laquelle elle s’ajoutait. Elle nous tordait littéralement les tripes. Associée aux brûlures d’estomac résultant des mêmes causes, elle nous ôtait 50 % de notre énergie. Pour ma part, en outre, je ressentais, depuis la veille, à la base de l’ongle du majeur droit, à chaque battement cardiaque, une douleur lancinante, conséquence probable de mon contact brutal avec le buisson d’épineux qui m’avait accueilli après notre naufrage.
A l’aube, nous fûmes toutefois heureux et satisfaits de la distance parcourue : autant que la veille sinon plus. Dans la journée, après un sommeil plus agité que les jours précédents par suite de la chaleur accablante et des fourmis rouges, notre repas, en raison de l’état lamentable de notre appareil digestif et à défaut d’autre chose, se limita à quelques pousses de bambou.
Avant de démarrer pour la cinquième nuit, je m’étais posé la question de savoir si nous atteindrions Vietri à l’aube. Montagne le croyait fermement, moi pas. Quoiqu’il en fut, nous ne ménageâmes pas nos efforts. Mais plus nous avancions, plus la rivière s’élargissait, partant plus la vitesse du courant diminuait, en dépit des nombreuses trombes d’eau qui s’abattaient sur la région. Si, au cours des premières nuits, les pagaies n’avaient servi pratiquement qu’au guidage, ce n’était plus le cas. Il fallait maintenant souquer dur pour maintenir une moyenne convenable, et dans la position à genoux inconfortable que nous étions obligés de garder, ce n’était pas facile, croyez moi. De plus, nous étions l’un et l’autre très fatigués. Placé devant moi, je sentais, au fil des kilomètres, que Montagne faiblissait ; ses coups de pagaie étaient plus lents. Il manqua plusieurs fois de tomber à l’eau, emporté par son élan qu’il ne parvenait plus à contrôler. Cependant, à la proposition que je lui fis de s’étendre un moment sur le radeau pour se reposer, il refusa catégoriquement.
La Rivière Claire s’élargissait de plus en plus. Nous avions navigué sans arrêt durant au moins cinq heures ; dans une heure, moins peut-être il ferait jour. Pour Montagne, Vietri n’était plus qu’à 4 ou 5 km ; pour moi, cette ville était encore distante d’au moins 25 km. En raison de nos opinions divergentes, une discussion franche pour décider de la conduite à tenir s’imposait sans retard. Je la provoquai en demandant à Montagne son avis.
Vietri, dit-il, est là devant nous. Nous y serons à l’aube. J’en suis persuadé. La rivière ne ment pas. Vois-tu comme elle s’élargit.
Je ne suis pas de ton avis, répliquai-je, pour les raisons suivantes. Crois-tu qu’à 4 ou 5 km de Vietri les viets laisseraient un cours d’eau aussi large sans surveillance ? Je ne le crois pas, et comme jusqu’à présent nous n’avons pas été inquiétés, j’en déduis que ce poste est encore à quelque 30 km.
Tu es trop pessimiste. Pourquoi veux-tu que les viets surveillent cet endroit plus qu’un autre ? Pour interdire l’accès de leur zone aux espions, ce n’est à coup sûr pas la rivière qu’ils choisiraient. U jungle est plus sûre pour ce genre d’activité.
Je ne suis pas pessimiste mais méfiant, dis-je. Mon séjour dans les camps de représailles m’a appris à l’être. C’est pourquoi je propose une dernière journée de repos. Elle permettrait de vérifier si mes craintes sont fondées, et si oui, de lâcher la rivière pour la jungle pour parcourir les derniers kilomètres.
J’ai foi en Dieu, dit Montagne. Depuis notre départ, il nous a guidés. Nous avons eu des coups durs : nous nous en sommes toujours sortis. Si nous avons souffert, c’est que nous le méritions. Aujourd’hui, dimanche, il ne nous laissera pas tomber. Nous arriverons à Vietri suffisamment tôt pour assister à la messe et le remercier.
Montagne, comme toi je suis croyant et veux bien admettre que Dieu nous a aidés et guidés. Mais de là à penser qu’il nous abandonnerait parce que, par simple mesure de prudence, nous n’assisterions pas à sa messe d’aujourd’hui, non ! En attendant une journée de plus, nous ne ferions preuve que de sagesse, vertu qu’il a toujours prônée.
Tu as peut-être raison, mais je dois t’avouer que je ne me sens plus ni la force, ni la volonté de tenir un jour de plus. Je suis au bout du rouleau, vidé, complètement vidé.
Dans ces conditions, continuons, et à la grâce de Dieu.
J’avais cédé, je n’aurais pas dû le faire. C’était bien la preuve que moi aussi je faiblissais.
Mon consentement avait redonné de la vigueur à mon camarade. Nous foncions comme au meilleur temps de notre forme, en dépit d’un vent contraire. Ce n’était en effet pas le moment de musarder, nous n’avions plus le temps de faire beaucoup de kilomètres avant le lever du jour. Bientôt, nous entrâmes dans un épais brouillard, qui à mesure que nous avancions blanchissait. C’était là le signe annonciateur de l’aube. Jamais nous n’étions restés aussi tard sur la rivière. Pressentant que nous n’arriverions pas à destination avant le jour, je proposai à Montagne de nous arrêter. Faisant amende honorable, il accepta sans réticence.
Immédiatement, nous obliquâmes vers la rive droite, côté Vietri. Au même moment surgit de la brume devant nous, à dix mètres à peine, une barque silencieuse, qui à force de voile et de rames remontait- la rivière. Aussitôt, de l’embarcation, des cris s’élevèrent "Tu-binhs ! Tu-binhs !" Nous avions été repérés et identifiés, malgré notre promptitude à virer de bord dès l’apparition de la barque. Un long son de corne retentit. A ce signal d’alarme répondit sans retard le tocsin d’une église ou d’une chapelle. En moins de dix minutes, toute la population allait être sur pied.
Nous avions une chance sur mille de nous en tirer. De toutes les forces qui nous restaient, nous pagayâmes vers la rive gauche. Gênés dans leur manoeuvre par leur voile, nos poursuivants perdirent immédiatement du terrain et disparurent dans l’épais brouillard hors de notre vue.
Arrivés près de la rive, une nouvelle difficulté se présenta. Cette rive était haute de près de quatre mètres. Comment allions-nous faire pour y grimper ? En la longeant, nous trouvâmes enfin l’arbuste sauveur. Sitôt sur la tertre ferme, nous courûmes droit devant nous vers la jungle que nous croyons proche, mais que le brouillard dissimulait toujours à nos yeux.
Notre premier élan fut vite brisé ; nos jambes ne nous obéissaient plus, leur maintien, pendant cinq nuits consécutives, dans la pénible et inconfortable position du pagayeur à genoux leur avait enlevé toute élasticité. Epuisés, notre volonté de résistance aussi faiblissait. Au bout de deux cents mètres de course, mon camarade s’arrêta et s’assit. A mes encouragements, il répondit, d’un air las et résigné
"Je ne suis plus qu’un poids mort. Va-t-en ! Seul tu as une chance de t’en sortir. Je t’ai assez créé d’ennuis comme ça. Tout ce qui arrive est de ma faute".
Je le raisonnai et lui annonçai en même temps ma ferme décision de ne pas le lâcher quoi qu’il arrivât. Mon accent de sincérité, et le rappel du sentiment de solidarité qui jusqu’alors nous avait unis l’incitèrent à repartir malgré son extrême faiblesse et son découragement.
Après cinq mètres de course, nous atteignîmes les premiers fourrés, et nous nous y enfonçâmes, sans souci des racines qui nous écorchaient pieds et chevilles, des branches et des épines qui nous déchiraient vêtements et peau. Chaque difficulté de parcours, de pénétration plus avant dans la brousse sapait progressivement la résistance de mon camarade. Je le voyais à son visage, je le sentais à sa respiration. Prétextant ma propre fatigue, je m’arrêtai et l’invitai à faire de même. B devait, attendre. ce signal, car immédiatement, sans un mot, il s’arrêta et- s’allongea. Il était à bout de forces. Je ne valais guère mieux.
Comme mon camarade, je m’étais étendu, ressentant tout à coup une grande lassitude. Fermant les yeux, j’essayais d’oublier notre situation présente. Des élancements de plus en plus aigus au majeur droit me rappelèrent très vite à la réalité. J’étais bon pour un panaris, c’était certain. J’avais pourtant bien assez de soucis et d’ennuis comme ça.
Le brouillard s’était dissipé, et il faisait maintenant grand jour. Tout autour de nous la forêt s’éveillait, la faune s’animait. Je prêtais l’oreille à tous les bruits, apparemment rien de suspect. Nos poursuivants avaient-ils perdu nos traces ? Nous recherchaient-ils toujours sur la rivière ? Dans ce cas, si notre radeau laissé à la dérive n’avait pas encore été trouvé, nous disposions d’un répit qu’il s’agissait de mettre à profit.
Après quelques secondes de réflexion, j’annonçai à Montagne mon intention de pousser une reconnaissance dans les environs. B acquiesça d’un grognement.
Au terme d’une progression lente et pénible à travers une végétation quasi-inextricable, je débouchai dans ce que je crus être une clairière. Amère déception 1 C’était une rizière. La jungle était en face, à plus de cinq cents mètres. Ainsi, notre couvert n’était en définitive qu’un simple petit bois entouré de rizières. Trompés par la brume, nous avions bien cru que nous entrions d’emblée dans la brousse.
Hormis quelques aboiements lointains, je ne décelai rien de suspect dans le secteur. J’aurais pu, à la minute présente, traverser ce no man’s land sans être vu. Pendant une fraction de seconde cette idée m’effleura. Bien qu’il m’eût donné son consentement, je ne pouvais ni n’avais le droit d’abandonner ainsi mon camarade. Le faire eût été une lâcheté. Honteux de moi, je revins sur mes pas, aussi rapidement que l’environnement me le permettait, pour faire part à Montagne de ma déconvenue et de la nécessité de rejoindre au plus vite la vraie jungle.
L’instinct de conservation aidant, il me suivit sans rechigner. A mesure que nous progressions, je constatai que les aboiements s’intensifiaient, se rapprochaient. Arrivés à l’endroit où j’étais il y avait dix minutes à peine, nous stoppâmes. Us chiens étaient à une cinquantaine de mètres sur notre droite. Un groupe d’hommes armés de fusils - vraisemblablement des miliciens - suivait à peu de distance. Sur notre gauche, au loin, même spectacle. Nous étions cernés, et les chiens, cette fois, nous avaient sentis. D’instinct, nous rebroussâmes chemin. Mais il était déjà trop tard : nous n’allâmes pas loin. De toutes parts, des hommes surgirent. En un instant nous fûmes saisis et emmenés sans ménagement, les poignets liés derrière le dos et les chevilles entravées.
Nous marchions comme des automates, l’esprit vide, anéantis, résignés à tout. De temps à autre, un "maolen" rauque, appuyé d’un coup de crosse nous rappelait qu’il fallait marcher plus vite. Précédés d’une multitude de mioches à demi-nus, nous pénétrâmes dans le village, où une foule excitée nous attendait. Immédiatement, deux hommes s’en détachèrent l’air menaçant. L’un d’eux me saisit par les cheveux et m’obligea, avec l’aide de son compagnon, à m’agenouiller, leva un coupe-coupe et fit le geste de me trancher la gorge. Dans le même temps, mon camarade était pris à partie par des femmes. Elles lui crachaient au visage, le giflaient. Us miliciens riaient et laissaient faire. A moins d’un miracle, je sentais que nous vivions les derniers instants de notre existence.
Un ordre bref, clamé en vietnamien, mit brusquement fin à cette hystérie collective. Etait-ce le miracle, ou simplement un répit avant la mise à mort définitive ? Les deux hommes me lâchèrent, la foule se fendit, recula. Je me relevai lentement. Face à moi, suivi de, deux bo-doï, s’avançait un homme jeune, 35 ans maximum. Vêtu d’une tenue de toile kaki clair, coiffé d’un casque colonial en feuilles de latanier, il distribuait à droite et à gauche des paroles sèches et dures, qui eurent pour effet de calmer les esprits ; il ordonna aux miliciens d’ôter nos liens puis s’adressa à nous en ces termes
"Messieurs, je déplore ce qui est arrivé et vous demande de pardonner aux tu-vé (miliciens) leur rudesse et à la population leur accès de mauvaise humeur. Je vous assure que ça ne se renouvellera pas. A partir de cet instant, vous êtes sous ma protection. Soyez sans crainte. Vous êtes dans un état lamentable et certainement très fatigués. Avant toute chose, il vous faut vous laver, vous restaurer et vous reposer. Suivez-moi".
Il avait parlé dans un français impeccable, sans accent. Depuis ma capture, aucun cadre viet ne m’avait parlé de la sorte. Son attitude simple, déférente même, exempte de toute fierté, son calme, le ton à la fois ferme et doux de sa voix nous inspirèrent confiance. Ce fut soulagés et sans appréhension que, flanqués de ses deux bo-d6i, nous le suivîmes en direction d’une maison en dur, genre "penty breton", où il nous invita à entrer. A l’intérieur, deux autres soldats : l’un entretenait du feu autour de l’inévitable théière maintenue constamment prête en cas de visite inopinée, l’autre nettoyait son pistolet-mitrailleur.
La maison était très sommairement aménagée. A droite, prenant tout le pignon, un bât-flanc où pouvaient facilement dormir côte-à-côte dix personnes, à gauche, en-deçà de la cheminée, une table et deux bancs. Face à la porte d’entrée, une autre porte donnant accès à la salle de douche.
Ses ordres donnés, notre hôte disparut en nous donnant rendez-vous pour midi. Ses hommes nous prirent alors en charge. Après un grand bol de thé chaud, accompagné de galettes de riz, nous fûmes invités à prendre une douche avec du vrai savon et en même temps à laver notre tenue. Pour ma part, je n’avais plus eu l’occasion, depuis le mois de mars, d’utiliser du savon pour ma toilette : c’était lors de mon séjour dans le troisième camp de représailles, grâce à la délicate attention du vieil infirmier. Pour Montagne, cet agréable souvenir remontait au 16 octobre 52, veille de sa capture. La douche prise, un des soldats badigeonna nos plaies avec de l’eau permanganatée et banda celles qui lui apparaissaient les plus infectées. Enfin, dans l’attente du repas de midi, les soldats, après nous avoir prêté à chacun un pantalon, nous firent signe de nous étendre sur le bat-flanc pour dormir.
Bien qu’elle nous surprit un peu, l’attention dont nous étions l’objet nous réconforta, et ce fut rassénés mais rompus de fatigue, les nerfs brisés par les récentes émotions que nous nous endormîmes.
"Allons, debout ! A table !". Notre hôte était à nouveau devant nous, souriant. Sur la table, il y avait un grand panier de riz fumant, un canard entier découpé en morceaux, agrémenté de courges et poivrons cuits, un bocal de nuoc-mam, une cruche de thé froid. Les bo-doï avaient disparu.
Nous nous installâmes face à ce curieux homme, au regard franc et sympathique, si différent de ses pairs. Pour nous mettre à l’aise, il nous servit, très largement, je dois le préciser. Malgré notre faim, nous nous efforçâmes de manger lentement, pour rester dignes.
Le premier, il rompit le silence pour demander nos noms et grades et des renseignements sur nos familles. Satisfait de nos réponses, il poursuivit
Reposés, lavés, vous avez meilleurs mine. Mais que vous êtes maigres Depuis combien de jours n’avez-vous pas mangé ?
Me tournant vers Montagne, je pris la parole avec son consentement.
- Depuis bientôt cinq jours, c’est-à-dire depuis que nous avons quitté le Camp 113, nous ne mangeons que des crudités glanées çà et là, au hasard de nos haltes. Mais au risque de vous choquer, je dois vous dire que depuis le 18 octobre 1952, date de notre capture, nous n’avons plus mangé à notre faim. C’est d’ailleurs la raison principale de notre évasion.
Mon interlocuteur observa un moment de silence. Ma réponse, bien qu’il s’y fut peut-être attendu, l’embarrassait.
Je comprends mal, dit-il. la ration allouée aux prisonniers de guerre est pourtant bien la même que celle des soldats de l’armée populaire. C’est d’ailleurs une décision du Président Ho-Chi-Minh.
- Théoriquement, c’est peut-être vrai, répondis-je. Mais pratiquement, non ! Notre état squelettique, qui a touché votre sensibilité, en constitue la preuve. Recevez-vous quelquefois des échos de la vie dans les camps de prisonniers ?
- De temps à autre, oui, notamment les activités du Camp N’ 1. Les textes de lettres et manifestes signés par les officiers français reflètent bien, à mon avis, leurs sentiments de reconnaissance à l’égard de notre Président et du peuple vietnamien tout entier. En conséquence, je pense qu’ils ne sont pas malheureux.
- Je ne sais pas ce qui se passe au Camp N’ 1, dis-je, mais si je m’en tiens aux principes d’égalité des droits, qui, d’après les cours politiques dispensés chaque jour au camp sont la base de votre mouvement de libération nationale, je ne pense pas que les officiers bénéficient d’un régime meilleur. Seuls peuvent jouer en leur faveur leur faible effectif permettant une meilleure organisation, et la présence de médecins compétents, ce qui est évidemment très précieux.
- Votre raisonnement est logique, dit-il, mais alors, qu’est-ce qui ne va pas au Camp 113 ?
En réponse à cette question, j’entrepris de lui faire le récit détaillé de notre vie de tous les jours, avec son cortège de misère et de morts. Quand j’en oubliais, Montagne complétait. Lancé à fond dans mon récit, j’en oubliais de manger, ce qui n’échappa pas à notre interlocuteur, qui gentiment me rappela à l’ordre pour faire honneur à son menu.
Mais tout a une fin ! En même temps que mon récit, le repas, aussi, s’acheva. Nous offrant tabac et papier, notre hôte nous donna son opinion.
- Eh bien, dit-il, aussi paradoxal que cela puisse vous paraître, je vous crois. C’est pourquoi j’ai décidé d’intervenir en votre faveur en vue de votre libération. Après que vous vous serez bien reposés, c’est-à-dire après demain, vous prendrez la route en direction de Vietri. Je donnerai à l’un des soldats qui vous accompagneront un rapport détaillé vous concernant, qu’il remettra au Commandement de Zone. Je dois maintenant vous quitter. Laissez la table telle quelle, mes soldats desserviront. Reposez-vous. Vous n’aurez pas trop de deux jours pour vous retaper.
Satisfait, mais néanmoins dérouté par la tournure des événements, je lui posai avant son départ cette question :
- Vous savez maintenant tout de nous. Mais vous, monsieur, qui êtes-vous donc pour vous intéresser ainsi au sort de deux français prisonniers, considérés et traités, par la majorité de vos semblables, comme des criminels de guerre ? Car, bien que nos arguments vous aient convaincu, nous n’avons pas moins enfreint le règlement du camp
Je suis colonel, répondit-il, et j’ai approximativement votre âge. Dans l’armée populaire de libération, la plupart des officiers supérieurs sont jeunes. Cette particularité n’empêche toutefois pas quelques-uns d’entre eux de raisonner, de faire la part des choses, d’essayer de comprendre, d’être humain. Vous ai-je à mon tour convaincus ?
Sa sincérité ne pouvait plus être mise en doute. Nous lui répondîmes oui" sans hésiter, mais en lui spécifiant toutefois les raisons qui nous contraignaient à tant de méfiance. Nous tendant la main, il nous quitta en nous donnant rendez-vous pour le lendemain.
Dès son départ, les soldats rappliquèrent. Après une sieste qui dura toute l’après-midi, la fin de la journée se passe tranquillement. Le repas du soir, presqu’aussi copieux que celui de midi, fut pris en compagnie des bodoï, qui nous firent ensuite l’honneur de tirer quelques bouffées de leur pipe à eau. Vu les circonstances, c’était en quelque sorte le calumet de la paix. Pour la nuit, nous couchâmes à l’une des extrémités du bat-flanc, les soldats à l’autre, chacun d’eux cependant assurant la garde à tour de rôle. Malgré le panaris qui me chatouillait désagréablement de plus en plus, je m’endormis très vite.
Le jour suivant, nous vécûmes une journée à peu près identique, au cours de laquelle le jeune colonel nous annonça notre mise en route en direction de Vietri à partir du lendemain huit heures.
Comme prévu, le lendemain, à l’heure prescrite, nous étions ..Prêts. Après s’être enquis de notre état de santé et avoir remis, avec ses recommandations, à l’un des soldats désignés pour nous escorter l’enveloppe contenant le rapport nous concernant, le jeune colonel viet nous souhaita bonne chance en nous serrant une dernière fois la main. Et ce fut immédiatement le départ.
Près de la rivière toute proche, un passeur nous attendait pour nous transporter sur la rive droite, côté Vietri. Sur cette rive, la route vers ce poste longe la rivière sur près de 5 kms. Reposés, remis en confiance, nous marchions bon train. Montagne paraissait avoir retrouvé son second souffle. Notre surveillance était toute symbolique. Quelques carcasses rouillées d’auto-mitrailleuses et de half-tracks nous rappelèrent le passage des troupes françaises sur cette route mal entretenue. Mais point de plaques indicatrices susceptibles de nous renseigner sur la distance qui nous séparait encore de Vietri, et les quelques bornes kilométriques encore en place ne portaient plus depuis longtemps aucune inscription.
Après une dizaine de kilomètres de marche sur la route, nous prîmes sur la droite un chemin de terre. Ce fut aussi le moment choisi par le ciel pour nous arroser copieusement. Du même coup, notre allure diminua, car les chemins de terre par temps de pluie sont très glissants, surtout pour des pieds nus, et c’était malheureusement notre cas.
Vers midi, nous fîmes halte dans une cabane aux murs de torchis où nous fûmes accueillis par un vieux tonkinois d’une soixantaine d’années. Ancien bep (cuisinier) dans une famille française d’Hanoï avant l’occupation japonaise, il parlait notre langue d’une manière assez convenable pour quelqu’un qui n’avait jamais mis les pieds dans une école. Il devint notre interprète. Au cours du repas qu’il nous prépara, il nous apprit que c’était chez lui que nous allions attendre la décision du Commandant de Zone. Immédiatement après le repas, le bo-ddi porteur du rapport nous concernant s’en fut en brandissant fièrement son enveloppe.
Engageant la conversation avec le maître de maison, nous essayâmes de connaître notre position exacte. Mais le vieux était malin ! Il savait éluder les questions, et quand parfois il y répondait, c’était toujours d’une façon évasive. En revanche, en ce qui concernait l’implantation des troupes V.M. dans la région, dont il nous parla sans que nous l’eussions pressenti, notre interlocuteur était intarissable. A l’entendre, il y avait des soldats partout. Pourtant, hormis nos deux gardes, nous n’en avions pas vu un seul depuis le matin. J’en déduisis qu’il exagérait dans un but louable, certainement, qui ne pouvait être que celui d’écarter de nous toute idée de fuite tant que nous resterions sous son toit. Parlant le français, il risquait en effet d’être inquiété dans une telle éventualité.
Malgré ma douleur au doigt, je passai une nuit relativement calme. Au cours de la journée qui suivit, l’attente, avec ses incertitudes, me pesa. Montagne était également très nerveux. De plus, mon inflammation phlegmoneuse au médius droit me donnait des inquiétudes et me faisait terriblement souffrir. Aussi il est superflu de préciser que je passai une très mauvaise deuxième nuit, au cours de laquelle ma pensée, sans cesse vagabonde, passait sans transition d’images irréelles de joie que provoquerait une libération à celles - cruelles - de désespoir qui résulteraient d’un échec.
Au petit matin, n’y tenant plus, je décidai d’inciser mon panaris. Dans ce but, je demandai à notre hôte de bien vouloir bouillir de l’eau et d’affûter son canif. Quoique réticent, Montagne accepta de faire le chirurgien.
En moins d’une demi-heure tout était prêt pour l’opération. Montagne avait flambé son bistouri. La tête tournée à 45 degrés pour ne pas voir, la main posée sur la table, le bo-doï tenant ferme mon poignet, j’attendis. Dix secondes s’écoulèrent, interminables, sans que rien ne se passât. Au dernier moment, Montagne, victime de son appréhension et de ses nerfs, avait renoncé. Ni le bo-doï, ni l’ancien bep ne consentirent à le rempIacer. Alors, faisant appel à toute ma volonté, je décidai moi-même d’inciser.
S’agissant du majeur droit, il me fallait opérer de la main gauche, ce qui, pour le droitier que j’étais, ne facilita pas les choses. Maladroit de cette main, je dus procéder lentement pour ne pas inciser trop profondément ou tout simplement taper à côté.
Rassemblant mon courage, je posai, avec mille précautions, l’extrémité de la lame sur l’abcès, exerçai une légère pression sur cette partie de peau tendue à l’extrême, qui céda immédiatement. Sang et pus mélangés giclèrent sur la table. Je plongeai aussitôt mon doigt dans l’eau bouillie tiède placée à mes côtés et l’y laissai tremper. C’était fini
Avais-je eu mal ? Non. Mais j’avais eu très chaud. La sueur perlait à mon front. Comme moi, toute l’assistance semblait soulagée. Pour nous remettre de nos émotions, le vieux cuisinier offrit à chacun une rasade de choum (alcool de riz), dont quelques gouttes servirent également de désinfectant. Le bo-doï se chargea du pansement, sacrifiant, pour ce faire, son paquet de pansement individuel - vraisemblablement récupéré sur un soldat français mort ou fait prisonnier - ou encore dans les dépôts du Service de Santé tombés aux mains du Viet-Minh.
Cet intermède nous avait fait oublier pour un temps notre pénible situation d’attente. Nos deux compagnons, comprenant notre inquiétude grandissante, faisaient de leur mieux pour nous rassurer. "Plus c’est long, plus c’est bon ", répétait le vieil homme en souriant. Par son intermédiaire, le bodoï, enhardi par quatre jours passés en notre compagnie, donna aussi son opinion. Très justement, d’ailleurs, il fit savoir que le "Grand Chef" n’habitait pas à côté et qu’il avait certainement d’autres préoccupations et soucis que de se pencher immédiatement sur le cas de deux prisonniers. Nous le concevions aisément, mais il y avait tout de même de quoi être inquiet.
Vers les neuf heures, le second bo-doï, suivi de deux autres soldats pistolet-mitrailleur au poing, firent irruption dans la cabane. A son air désolé, nous comprîmes tout de suite que la démarche du jeune colonel au grand coeur avait échoué. Nous étions anéantis. Bien que nous eussions eu quelques doutes quant à sa réussite, il nous faut bien avouer, pour être francs, que nous y avions placé tous nos espoirs.
Nos deux nouveaux venus nous prirent immédiatement en charge. Leur air important donnait à penser qu’ils avaient reçu des consignes très strictes nous concernant. L’un d’eux, probablement un petit gradé, baragouinait quelques mots de français.
- Vous, dit-il, c’est retourner Camp 113. Nous, vous conduire’. Si vous évader, nous ordre vous tuer, compris ? En route, mao-len !
Dans le même temps, son camarade nous jeta sur les épaules les boudins de riz qu’ils avaient apporté. A peine s’il nous fut permis de dire adieu à ceux qui, ces derniers jours, nous avaient témoigné leur sympathie, et ce fut le départ.
Dès les premiers kilomètres, malgré les exhortations de nos deux gardes, nous adoptâmes la force d’inertie, tactique bien connue de tous les prisonniers, réduisant progressivement notre allure en alléguant la fatigue, et nous ne mentions pas, nous arrêtant plus souvent que nécessaire pour satisfaire nos besoins naturels.
En franchissant un talus, Montagne glissa et tomba, s’écorchant légèrement la plante du pied gauche. Il ne l’avait pas fait intentionnellement. Ce fut, néanmoins, une occasion d’arrêt, au cours duquel nous décidâmes, d’un commun accord, en cas de présentation d’une situation favorable, de tenter de fausser compagnie à nos gardes, soit simultanément, soit individuellement selon l’occasion, et le plus tôt possible. Il convenait en effet de profiter de notre proximité du secteur français de Vietri pour tenter l’ultime chance.
Montagne boîtait 1égèrement. Pour ne pas le fatiguer, je calquai mon allure sur la sienne. Cette manière de faire déplut à nos anges gardiens, qui nous intimèrent l’ordre de marcher plus vite. Lançant un coup d’oeil complice à mon compagnon, j’accélérai, avec la ferme intention de creuser un écart important entre nous. Au bout d’un kilomètre, j’avais pris une quinzaine de mètres sur Montagne. Me sachant plus alerte, les bo-doï m’encadraient, relâchant ainsi quelque peu la surveillance de mon camarade.
Nous marchions de cette façon depuis environ un bon quart d’heure lorsque soudain une rafale de P.M., tirée par le gradé placé à ma gauche, me fit tressaillir et retourner juste assez vite pour voir Montagne s’abattre dans .l’herbe bordant la route. Lâchant ma charge de riz, je courus vers lui, sourd aux cris et gestes menaçants des gardes, qui ne parvinrent à me stopper qu’à quelques pas seulement de mon infortuné compagnon. Il gisait dans l’herbe, la face contre terre, un bras replié sous le corps, la veste cunao rouge de sang, sans mouvement. Craintif, malgré l’air dur qu’il se donnait, son tueur s’en approcha, l’examina attentivement, lui tâta le pouls, puis le retournas.. en m’annonçant cyniquement : "Camarade tiet (mort)... lui désobéir, jeter sac de riz et courir vite pour filer brousse".
Furieux, je le traitai de lâche, d’assassin. Cette attitude contre nature pour un prisonnier me valut immédiatement une volée de coups de pied et de crosse que j’encaissai sans broncher.
Au fil des minutes, alertés par les coups de feu, des indigènes accoururent de toutes parts. Un groupe de miliciens, sorti on ne sut d’où, fit disperser tout ce monde. Son chef, dans lequel je devinai un officier, s’assura que mon compagnon était bien mort. Il interrogea ensuite longuement mes gardiens, prit connaissance des ordres écrits qu’ils détenaient, puis se tourna vers moi pour me dire en excellent français :
- Votre camarade est bien mort. E n’a que ce qu’il mérite. Je vous avertis que vous subirez le même sort si l’envie vous prend de l’imiter. Vous allez reprendre la route immédiatement pour le Camp 113, mais sous la conduite, cette fois, de deux miliciens, qui, je vous l’assure, savent se faire obéir.
Appelant mes nouveaux anges gardiens, il leur donna ses ordres. L’un d’eux était approximativement de ma taille (1,72 m), l’autre beaucoup plus petit. Ce qui ne les empêchait pas d’avoir un point commun : une tête de brute. A l’inverse des militaires de l’armée régulière, auxquels nous avions eu affaire jusqu’à présent, ceux-ci paraissaient plus âgés. Leur armement était également différent : au lieu du P.M., ils portaient le fusil, d’un type inconnu pour moi mais probablement de fabrication chinoise.
Tourné vers le cadavre de mon camarade et ami, je songeais à l’une des paroles qu’il avait prononcées sur la rivière peu de temps avant notre capture : "Dieu ne nous abandonnera pas". En quelque sorte Dieu ne l’avait pas abandonné : il l’avait tout simplement rappelé à lui. A cette évocation, je me mis à réciter une prière avant de lui adresser un dernier adieu.
Depuis combien de temps étions-nous arrêtés 9 Je n’en avais aucune idée. Le soleil était au zénith.
Dès le départ, pour me mettre dans l’ambiance, en plus de mon boudin de riz (15 kilos environ), j’héritai de celui de mon malheureux compagnon. C’était donc avec une charge de 30 kilos sur les épaules, poids qui chaque jour ne diminua que de trois rations, que j’allais refaire, toujours pieds nus, les 300 à 350 km qui me séparaient encore du Camp 113. Après ce dernier choc brutal, je craignais de ne jamais y parvenir, tant je me sentais physiquement et moralement las. Pourtant, cette première et tragique journée du retour vers le camp s’acheva sans autre incident, hormis quelques coups de pied au cul de temps à autre. Il en fut ainsi pendant encore sept autres jours, c’est-à-dire jusqu’à ce que la faim, la soif, la fatigue, les plaies aux pieds et chevilles, la chiasse, la fièvre, l’hostilité permanente et la brutalité de mes gardes vinssent à bout de ma capacité de résistance.
L’étape quotidienne, longue d’environ 30 km, était parcourue en deux demi-étapes de trois heures de marche chacune, séparées par le repas de midi, seul temps de pause accordé en dehors des arrêts dysentériques. La boule de riz sans sel tenait facilement dans le creux de la main (200 g par repas approximativement) et rien d’autre. Comme boisson, un quart de thé ou de goyave ou rien du tout, selon l’humeur des gardes. Ration de liquide nettement insuffisante pour un sujet déjà déshydraté, en état de transpiration permanente, qu’il fallait compenser, sous peine d’inanition à brève échéance, par l’eau impaludée des ruisseaux.
Si dans la journée j’étais pratiquement libre de mes mouvements dans un rayon de deux mètres, il n’en était pas de même les nuits, au cours desquelles je couchais toujours dans la position allongée sur le dos, chevilles et poignets attachés aux lames de plancher disjointes des cagnas paysanne qui nous accueillaient. Position pour le moins inconfortable pour se gratter et qui ne facilitait pas non plus les choses lorsque subitement dans la nuit la courante vous prenait et que votre gardien, soit par flemme, soit par méchanceté, tardait à vous’ délivrer de vos liens pour vous accompagner dans la nature.
Le 9ème jour, après une nuit extrêmement agitée à la suite de trois sorties peu espacées aux feuillées, je fus pris à mon réveil de maux d’estomac intolérables suivis de vomissements. Malgré mes efforts pour y parvenir, je ne pouvais prendre la position susceptible, en la circonstance, de me soulager. Mes liens étaient trop serrés. L’estomac pratiquement vide, je ne rendais qu’un mélange écoeurant de bile et liquide de stase, qui à chaque rejet coulait le long de ma veste. Les contractions stomacales étaient telles que j’avais l’impression d’étouffer. J’avais des sueurs froides. Ce triste spectacle provoqua l’hilarité de mes antipathiques gardes-chiourmes, qui ne défirent mes liens que sur les instances expresses du maître de maison, que mon état pitoyable avait sensibilisé. Ce fut également ce brave homme qui, en me servant une mixture de sa composition, parvint à calmer mes douleurs, qu’il mettait sur le compte des ascaris.
Cet incident avait considérablement retardé notre départ. Cette perte de temps, et plus encore, je pense, la leçon d’humanité reçue de l’humble nhia-qué (paysan) avaient exaspéré mes guides. Aussi, dès que nous eûmes disparu hors de sa vue, un retentissant mao-len, appuyé d’une volée de coups de crosse me fit clairement comprendre les désirs et les intentions des brutes attachées à ma personne. Il fallait rattraper le temps perdu.
Malgré tout mon courage et ma bonne volonté, je ne pus soute..’. longtemps la cadence imposée. Inévitablement, au fil des kilomètres, elle diminuait, ce qui n’était pas du goût de mes compagnons, qui à tour de rôle renouvelèrent en cours de route l’opération coups de pied au cul ou coups de crosse chaque fois qu’ils la jugeaient utile.
Rompu de fatigue, je m’endormis au cours de la pause casse-croûte de midi. Mon réveil fut brutal. Le plus grand - et le plus méchant - des miliciens, histoire de rire, marcha sur ma main droite. Instinctivement je la retirai, lui laissant sous la sandale le pansement qui enveloppait et protégeait mon doigt. L’agréable constatation d’une cicatrice rose et creuse, du plus bel aspect, en lieu et place du panaris calma mon ressentiment à l’égard de mon tortionnaire.
A cet arrêt succéda une mise en train pénible, tant je souffrais des pieds. Mais à la longue le corps humain s’habitue à tout, même à la douleur. D’autres avant moi en avaient fait la triste expérience. Cette réflexion, qui en l’occurrence était une consolation me permit d’atteindre, sans m’effondrer, le poste de garde qui allait nous servir de refuge pour la nuit.
Dans cette hutte délabrée cohabitaient cinq miliciens et une jeune femme, pour lesquels je devins immédiatement un objet de curiosité. Je n’était pourtant pas beau à regarder ! Mon dernier coup de tondeuse (barbe et cheveux) datait du ler juillet. Depuis neuf jours, je ne m’était pratiquement pas lavé. Mon corps, dont j’avais dénudé la partie supérieure pour goûter un soupçon de fraîcheur était couvert d’une multitude de pustules purulentes, qui avec les poux multipliaient les sources de démangeaisons et lorsqu’elles crevaient faisaient coller à ma peau le tissu déjà dégoûtant de transpiration et de poussière de ma tenue de paysan. Mes pieds et chevilles gonflées par le béri-béri et les plaies infectées rappelaient d’une manière grotesque des’ pieds-bots. Bref, j’avais tout du clochard sale, infirme et pouilleux.
Je n’inspirais cependant aucune pitié à tout ce monde réuni, au milieu duquel mon grand escogriffe de garde racontait mon odyssée avec force gestes. A en juger par les regards de haine que m’adressait l’assistance, j’en déduisis qu’il m’accusait de tous les crimes possibles et imaginables. Aussi, lorsqu’un tant soit peu reposé, je demandai à celui qui me paraissait être le chef l’autorisation d’aller me laver au ruisseau coulant à deux pas de la cabane, j’essuyai un refus catégorique, appuyé par toute l’assistance, à l’exception toutefois de la femme, dont l’expression, au cours de la discussion qui s’ensuivit me donna à penser qu’elle éprouvait à mon égard une certaine compassion.
Cette attitude se confirma, une première fois lorsqu’elle m’apporta ma ration de riz, dont le volume était double des repas précédents, une seconde fois lors des dispositions préliminaires prises à mon égard pour la nuit. Là elle s’opposa de toute son énergie à ce que l’on m’enserrât les chevilles dans un carcan de fortune. Elle ne put cependant pas empêcher mes gardes de me ligoter, comme toutes les nuits.
Harcelé par les poux et les moustiques, pratiquement à bout de force, sans pour cela que mes nerfs se fussent calmés, je ne m’endormis qu’à une heure très avancée de la nuit. Ce fut donc sans avoir pu bénéficier du temps nécessaire pour récupérer un peu de mes forces qu’il me fallut reprendre la piste pour l’étape, qui, d’après mes souvenir de passage dans la région en cours de corvées, devait être la dernière avant le Camp 113. Compte tenu de mon état d’épuisement, de l’état de mes pieds, dont la plante était par endroits à vif, je savais déjà par avance que cette étape serait longue et dure mais j’étais loin de penser aux difficultés et aux souffrances qu’en définitive j’allais devoir supporter.
Depuis trois jours, tous les matins, mes premiers pas étaient hésitants, pénibles. Ils le furent encore plus ce jour-là. Le fait même de poser le pied par terre devenait intolérable et produisait l’effet d’une décharge électrique, qui se répercutait dans tout mon corps. Contraint et forcé par les deux brutes qui me harcelaient, je repris néanmoins la cadence imposée.
Après une demi-heure de marche forcée, j’en était à me demander si l’occasion allait m’être, une dernière fois, donnée de revoir mes camarades du Camp 113 avant de mourir. Je marchais comme un automate mal réglé, l’esprit ailleurs, ballotté de droite et de gauche par les coups, courbant l’échine sous les quelque 12 kilos de riz qui me restaient encore, les nerfs bandés pour ne pas céder aux souffrances, pour ne pas tomber, pour ne pas flancher.
Je n’étais pourtant plus bien loin du camp, je reconnaissais bien la route menant au pont de Vinh-Thuy. Malgré mon désir ardent de traverser ce pont avant midi et la furie conjuguée de mes tortionnaires, il fallut s’arrêter avant, car, à la fatigue et aux misères du moment vint s’ajouter un autre mal, déjà très pénible à supporter lorsqu’il est seul : la crise de palu.
Une hutte paysanne sur pilotis se trouva à point nommé pour m’accueillir. Bon gré mal gré, je décidai de m’y arrêter car je n’en pouvais plus. Je m’affalai sur l’échelle menant à la pièce commune, indifférent aux cris et aux coups de mes gardes. L’apparition du propriétaire de la maison calma leur ardeur. Aidé par le paysan, je gravis alors les quelques marches menant à son logis où je m’écroulai, terrassé par la fièvre. Bien qu’il fit une chaleur étouffante, je grelottais à en faire trembler le plancher.
Les deux miliciens, décontenancés une fois de plus par l’attitude charitable d’un des leurs, n’intervinrent plus. Indifférents à mes malheurs, ils s’affairaient à la préparation du repas. Par contre, mon hôte ne chômait pas. Ayant réuni une grande brassée de paille de riz, il en disposa une partie sur le plancher en guise de litière et m’aida à m’y étendre. Lorsque je fus bien installé, il me recouvrit de la tête aux pieds avec le reste de la paille. L’ayant remercié d’un geste, je sombrai illico dans une demi-inconscience, anéanti autant par la maladie que par l’épuisement.
Combien de temps dura ma crise ? Je fus incapable de répondre. Aux tremblements du début avait succédé une sudation intense, elle-même suivie d’une torpeur bienfaisante. Ma bouche était sèche, je ne salivais plus, j’avais une soif terrible. Devançant mon appel, le brave paysan m’apporta une grande écuelle de thé tiède que je bus presque d’un trait.
S’étant aperçu que je revenais peu à peu à moi, le moins antipathique des gardes m’apporta ma ration de riz. J’y touchai à peine, ça ne passait pas. J’avais la bouche trop sèche, et puis d’ailleurs je n’avais pas faim : ma soif intense du moment primait sur tout le reste. Sur un signe, notre hôte m’apporta une seconde tasse de thé, à laquelle je n’eus pas le temps de goûter. Exaspérée sans doute par la sollicitude de son compatriote à mon égard, la grande brute de garde m’arracha le bol des mains et vida son contenu sur le plancher, puis saisissant son fusil il m’ordonna d’un geste menaçant de me lever pour reprendre la route. Conscient de ma faiblesse, j’hésitais à descendre l’échelle. Un coup de pied au cul bien appliqué me fit avancer d’un pas ; en même temps le paysan s’était précipité, d’abord pour rabrouer de façon énergique le grand milicien, et ensuite m’aider à descendre. La bonté de cet homme n’avait d’égale que la cruauté de mes bourreaux.
Toujours sous l’effet paralysant de mon accès de palu, je repris la route sans grande conviction sur mes réelles possibilités de rallier le camp dans la journée. Ma faiblesse était telle que je n’arrivais plus à éviter les cailloux qui usaient et déchiraient de plus en plus mes plantes de pieds. A chaque pas je vacillais, chaque coup de crosse me déséquilibrait. Mes muscles étaient raides. Je me déplaçais comme un pantin désarticulé dont les ficelles trop usées étaient sur le point de céder.
A la méchanceté des hommes se mêla bientôt le déchaînement des éléments. Le vent se leva pour souffler en bourrasques ; puis ce fut l’orage. En moins de cinq secondes, je fus trempé de la tête aux pieds. Mes gardes aussi, bien entendu. Mais il ne fut pas question pour autant de chercher un abri et s’arrêter.
C’est dans ces pénibles dispositions et conditions que j’abordai le pont branlant de Vinh -Thuy, moitié ferraille moitié bambou, dont la largeur en sa partie rafistolée n’excédait pas deux mètres. L’absence totale de garde-fou, sur ce même tronçon, m’avait toujours fait appréhender la traversée, même en temps ordinaire. Ce jour-là l’appréhension faisait place à la peur. Peur en raison de ma faiblesse, peur de céder au vertige, peur d’être projeté par une rafale de vent dans les eaux qui coulaient à trente mètres plus bas, et dont je n’aurais pas eu, cette fois-ci, la force de me dégager.
Aussi j’hésitai à m’y aventurer. Mais mon hésitation devait être de courte durée. Mes anges gardiens y remédièrent instantanément en redoublant de violence. Dompté, je dus, dans un dernier effort de volonté, me diriger vers mon destin.
Dès les premiers pas, je ressentis les oscillations irrégulières du tablier de bambou sous l’effet des coups de vent. Pris de vertige, je me laissai tomber à quatre pattes, m’accrochant désespérément aux lames de bambou entrelacées. C’est dans cette position qu’en définitive je repris ma marche en avant, marche lente et pénible, entravée par les balancements incessants de la charge de riz suspendue à mon cou.
Derrière moi, mes compagnons, malgré leur superbe, avaient été eux aussi contraints de m’imiter. Mais ils eurent vite fait de ma rattraper, permettant ainsi au plus inhumain d’entre eux - qui me suivait à me toucher de me labourer avec une satisfaction évidente l’arrière-train avec le canon de son arme, car en dépit de mes efforts pour aller plus vite je n’y parvenais pas. J’avais l’impression de traîner derrière moi, attaché à chaque jambe, un boulet. Ce petit jeu cruel dura tout le temps de la traversée du tronçon instable. Arrivé sur la partie stable du pont, je poussai un soupir de soulagement et essayai de me relever. Ce fut en vain. La merveilleuse machine ne répondait plus aux sollicitations de son maître, ni celles - beaucoup plus énergiques - de mes bourreaux. Sous les coups, je me sentais soudain défaillir, pour sombrer instantanément dans le néant.
Evanoui au milieu du pont, je me retrouvai à mon réveil en plein centre de Vinh-Thuy, étendu à plat ventre dans une flaque d’eau, offert à la curiosité des indigènes. Sur ma nuque coulait un jet d’eau fraîche, sorti d’un bambou creux, dernier élément d’une canalisation draînant l’eau de source de la colline voisine vers l’agglomération.
La pluie avait cessé, le vent s’était calmé. A mes côtés, mes fidèles compagnons veillaient. Dès les premiers signes de reprise de vie, ils me remirent sur pied. J’avais mal partout, les membres raides, du sang coulait de mon front fendu par un silex. Mais tout ceci n’était rien comparé à la vive douleur que je ressentis au coccyx, à la suite du coup de pied administré par l’un des gardes dans le but très précis de me remettre au plus vite dans l’ambiance. La douleur fut telle que je dus me cramponner à un curieux pour ne pas retomber. Plus tard, après avoir tâté l’endroit douloureux, je dus me rendre à l’évidence : j’avais le coccyx disjoint et recourbé vers l’intérieur, ainsi que tout le bas du dos et le hanches meurtris.
Enfin, en examinant l’état de ma tenue, déchirée aux genoux et les écorchures toutes fraîches apparaissant aux mêmes endroits, j’imaginai aisément la correction que j’avais dû recevoir avant et pendant mon évanouissement. Mes tortionnaires avaient d’abord dû essayer de me réveiller à coups de pied et de crosse, d’où ma blessure au coccyx et les meurtrissures diverses, puis devant l’insuccès de leur tentative ils m’avaient traîné, chacun par un bras, jusqu’au village pour bénéficier du concours éventuel des habitants.
De plus en plus tenaillé par la soif, l’eau m’attirait irrésistiblement, et je bus à même le bambou creux, sans souci des microbes, bactéries et autres virus ou parasites que cette eau, pourtant claire et limpide, pouvait contenir. Mais je profitai peu de cette douceur de la nature ; deux bras solides m’agrippèrent et me poussèrent, arguments à l’appui, dans la direction de la piste menant au Camp 113.
Il me restait encore une quinzaine de kilomètres à faire pour rejoindre mes camarades. Depuis la fin tragique de mon ami, j’avais hâte de les retrouver, pour ne plus me sentir seul, pour bénéficier de leur soutien moral.
Malheureusement, le camp était encore loin, et si par chance j’y parvenais, comment y serais-je reçu ? Sans doute assez mal. Il me faudrait tenir compte de l’état d’esprit issu des répercussions que ma tentative d’évasion n’avait pas manqué de provoquer, bouleversant - c’était certain - la déjà bien misérable existence de mes camarades. Et puis il y avait les autorités. Que me réservaient-elles, celles-là ? Autant d’inconnues dont il faudrait tenir compte.
J’en étais là de mes réflexions lorsque la grande brute de milicien me rappela brutalement à ses bons souvenirs avec un magistral coup de pied au bon endroit qui m’arracha un cri de douleur et faillit me faire tomber une nouvelle fois dans les pommes.
Cette piste que je foulais peut-être pour la dernière fois, je la connaissais dans ses moindres recoins ; les passages dangereux et glissants, comme les branches et les racines traîtresses qu’en temps ordinaire je parvenais à franchir ou à éviter sans difficulté. Ce jour-là, tout était difficile. Je buttais, glissais, tombais, incapable de sauter le moindre obstacle. Chaque pas exigeait de moi un effort douloureux. Franchir un talus, traverser un ruisseau, marcher sur une diguette devenaient une entreprise périlleuse. Bouche et gorge sèches, j’avais une soif terrible. Déshydraté, je n’urinais plus ni ne transpirais plus malgré la chaleur torride. Bien que j’eusse le ventre vide depuis la veille au soir, je n’avais pas faim. Bousculé ou battu parce que je ne marchais pas assez vite, je gravissais mon calvaire sans un mot, dents serrées, pour ne pas céder aux souffrances ni au découragement, essayant de repousser toujours plus loin les limites de ma résistance.
Ce fut dans ces conditions, réduit à l’état de véritable loque humaine, que j’atteignis, enfin de journée, le Camp 113.
Froidement accueilli par le surveillant général, je fus aussitôt enfermé dans une cabane isolée, obscure, infecte, dont l’approche était strictement interdite aux autres prisonniers. Véritablement au bout du rouleau, je m’écroulai sur le sol dès la porte franchie et m’endormis, indifférent à l’odeur de mort qui flottait dans l’air.
Ma nuit de retour au camp fut très agitée. Poursuivi en rêve par mon grand escogriffe de milicien, qui pour la circonstance avait troqué son fusil contre un poignard, je me réveillai en sursaut au petit matin, angoissé, haletant, oppressé, le coeur battant à tout rompre. Poursuivant mon cauchemar tout éveillé, j’eus bientôt l’impression d’une présence, alors que la veille, à mon arrivée, je n’avais ni vu ni entendu personne. Au fil des secondes et des battements précipités de mon coeur, cette présence se précisait. De quoi s’agissait-il ? D’un homme ou d’un animal. Recroquevillé dans mon coin, n’osant faire un mouvement, je me tenais sur la défensive dans la mesure où mes muscles endoloris et autres blessures me le permettaient. A la longue, je parvins à distinguer dans l’obscurité le contour d’une silhouette.
Cet homme, car il s’agissait bien d’un homme, ayant certainement deviné mon inquiétude, ma peur devrais-je dire, me rassura par ces mots "N’ayez pas peur, mon adjudant-chef, c’est moi, Walter, le légionnaire..."
Reconnaissant sa voix, je voulue lui répondre : peine perdue. Seul un grognement sortit de ma bouche archi-sèche, dans laquelle ma langue, démesurément enflée, prenait trop de place. Devinant mes difficultés, Walter m’entraîna vers la porte, qu’il entrebâilla dans la mesure où le système de fermeture le permettait et m’examina sur toutes les coutures. Quand il eut fini, il s’exclama : "Eh bien dites donc, ils vous ont drôlement arrangé, les salauds!"
Toujours désireux de me rendre service, mon nouveau compagnon me fit boire son reste de goyave de la veille. L’absorption d’une aussi petite quantité de liquide ne me redonna pas immédiatement l’usa e de la parole, ce qui réduisit la conversation au seul monologue de Walter, qui la veille au soir n’avait pas osé, en raison de mon état de fatigue, m’adresser la parole, ni même donner signe de vie, afin de me permettre de me reposer. En agissant de la sorte, il ne songeait certainement pas à la frousse que sa présence allait susciter le lendemain.
En prison depuis douze jours, Walter était le dernier survivant d’un groupe de dix hommes de troupe, qui enhardis par l’audace de leurs aînés avaient, à leur tour, voulu tenter la belle dans les jours qui suivirent immédiatement notre départ. Le moment était pourtant mal choisi pour renouveler une expédition de ce type à si peu d’intervalle. En effet, à la suite de notre disparition, toute la région était en état d’alerte. Aussi furent-ils repris, les uns après les autres, dans le minimum de temps. C’étaient, à l’exception de Walter, des jeunes gens de 18 à 25 ans, trop diminués physiquement pour mener à bien une telle tentative. Enfermés dans cette prison dès leur capture, ils y étaient morts l’un après l’autre, usés par la fatigue, la maladie, la soif, la faim, le désespoir, las de vivre dans ce camp de concentration exotique où les prisonniers étaient condamnés à mourir sous le double signe de la clémence du Président Ho-Chi-Minh et de la fraternité des peuples.
L’annonce de ce nouvel et dramatique épisode de la vie au camp ne fut pas de nature à remonter mon moral, bien gravement atteint en ce début de d’août 1953. Mes chances de survie étaient bien compromises. Pour moi, is cas pouvaient se présenter. Si, compte tenu de mes antécédents, je n’étais pas soit condamné à mort et fusillé, soit renvoyé en camp de représailles d’où je ne reviendrais plus, je devais tôt ou tard, à moins d’un miracle, subir le sort de ceux qui m’avaient précédé dans cette prison. Dans les trois hypothèses, la mort était au bout du compte.
Nonobstant ces tristes perspectives, le simple fait d’avoir retrouve e un compagnon fut pour moi d’un grand réconfort. J’en avais bien besoin, j’étais dans un état pitoyable. Ce que Walter avait dit n’était que trop réel. En effet, ils m’avaient bien arrangé, les salauds. J’étais horrible à voir, squelettique, sale. Mon épiderme jaune était couvert d’hématomes, parsemé de pustules. Mes pieds et chevilles démesurément gonflés portaient sur toutes les faces des plaies infectées où mouches et asticots se disputaient pus, sang, humeur.
Notre triste et sombre cabane de ké-fen, boue séchée et roseaux, n’avait d’ouverture que la porte, toujours fermée sauf aux heures des repas. Elle était traversée dans toute sa largeur par une tranchée de cinquante centimètres de largeur et de profondeur, dans laquelle coulait un ruisseau alimenté en eau courante par la rivière toute proche. Ce ruisseau avait deux usages. Dans sa partie haute, les prisonniers y faisaient leur toilette ; dans la partie basse ils avaient aménagé leur "chiotte". Il y régnait, en particulier aux heures de pleine chaleur, une odeur pestilentielle odeur de mort et d’excréments mélangée.
Nos repas nous étaient apportés, deux fois par jour, par un camarade choisi parmi les plus endoctrinés. Toujours accompagné d’un garde, il déposait nos deux paniers de riz et bambous creux de goyave sur le pas de la porte et repartait aussitôt sans jamais prononcer un mot, sans jamais s’inquiéter de notre état de santé, sans jamais un regard de commisération. Certes, les consignes à notre encontre devaient être strictes, mais elles n’exigeaient tout de même pas, de la part d’un prisonnier français si endoctriné fut-il, une telle attitude à l’égard de camarades de misère encore plus malheureux que lui, bien qu’ils eussent choisi une voie radicalement opposée à la sienne pour essayer, tout en gardant leur dignité, de fuir ce camp de la mort lente. Cette manière de se comporter reflétait bien l’état d’esprit d’un certain clan, pour qui la notion de solidarité n’avait plus cours.
Grâce au sacrifice de Walter, qui me cédait chaque jour une partie de sa ration de goyave - en compensation je lui cédais une partie de mon riz - je recouvrai au bout du troisième jour l’usage de la parole. Ma langue s’était désenflée progressivement en maintenant dans la bouche aussi longtemps que possible une petite quantité de goyave, renouvelée en fonction des disponibilités. Mais je dus poursuivre ce traitement pendant encore six jours pour qu’enfin mes glandes salivaires reprissent normalement leur fonction.
L’appétit revint également petit à petit en m’efforçant chaque jour de manger davantage de riz que mon estomac voulait recevoir. Par contre, mes forces semblaient m’avoir abandonné à tout jamais. Mes muscles ankylosés gardaient leur raideur, mes articulations demeuraient douloureuses. Quant à mes plaies aux pieds et chevilles, pour lesquelles il ne fut jamais question de soins, je devais me contenter de bains de pieds dans le ruisseau à tout faire. Kemen, malgré sa demande à BOUDAREL et au chef de camp, ne fut jamais autorisé à me rendre visite, ni, à plus forte raison, à me soigner.
Les journées étaient interminables. Confiné dans un espace réduit, incapable de m’asseoir, à cause de mon coccyx douloureux, je passais la plus grande partie de mon temps dans la position allongée sur le côté, plongé dans mes pensées, constamment sur le qui-vive, tressaillant au moindre bruit, m’attendant, à chaque fois à ce que la porte s’ouvrait, à voir surgir le surveillant général et à l’entendre prononcer la phrase fatidique : "Capitaine, suivez-moi !"
Comme les jours, les nuits étaient également longues. Malgré ma lassitude, je ne parvenais jamais à m’endormir avant minuit ou une heure du matin, et dès que je m’endormais, les cauchemars m’assaillaient. Je revivais chaque nuit les péripéties de mon aventure, toujours déformées, surnaturelles.
Agitation nocturne et longues journées d’attente déprimantes entretenaient chez moi une psychose d’angoisse permanente, que, malgré ma volonté, j’étais incapable de surmonter. Jamais je n’étais parvenu à un tel degré de délabrement physique et moral ; j’étais à bout de nerfs, ma raison même vacillait.
Dans l’après-midi du dixième jour, au cours d’une brève visite, le surveillant général nous annonça d’un ton solennel :
"Le chef de camp, toujours fidèle à ses principes humanitaires et à la politique de clémence préconisée par notre Président, a décidé de soumettre votre sort à la décision de vos camarades au cours d’un débat qui sera clos par un vote. Si son résultat vous est favorable, vous serez immédiatement autorisés à réintégrer la communauté ; dans le cas contraire, vous resterez en prison jusqu’à ce que les instances supérieures aient décidé de vos destins. Avant toute chose, il est toutefois indispensable que vous fassiez votre autocritique publique afin de permettre à chacun de vos camarades de juger en son âme et conscience".
Nous reçûmes, en conséquence, papier et crayon nécessaires à la rédaction de notre confession. Personnellement je n’en avais pas besoin : je savais déjà ce que j’allais dire.
Ce n’étaient pas des considérations d’ordre humanitaire qui avaient amené le chef de camp à accepter la solution envisagée. La vérité était tout autre. En réalité, il y avait été contraint par le mécontentement grandissant, le vent de révolte qui soufflait sur le camp depuis les décès successifs, en moins d’une semaine, de neuf de leurs camarades incarcérés pour le motif que l’on sait et dont la mort n’avait pu résulter que des sévices subis et des rigueurs de leur détention. Je le sus le lendemain. A l’origine de cette prise de conscience, de ce mouvement de solidarité, il y avait le Capitaine Thomasi, seul officier encore présent au camp, la plupart des chefs de groupe, tous nos bons camarades : en résumé tous ceux qui, pourvus d’un peu de dignité, avaient encore conscience de l’ignoble jeu que les autorités leur faisaient jouer et dont ils allaient être, un jour ou l’autre, les victimes.
Notre comparution devant cette sorte de tribunal du peuple, constitué par tous les prisonniers, réunis sous la présidence du Chef de Camp, flanqué de son hypocrite adjoint BOUDAREL, eut lieu le lendemain. Soutenu par deux bo-doï, je mis près de cinq minutes pour grimper les 200 mètres de dénivellation qui séparaient notre prison du lieu de réunion habituel et je dus à nouveau serrer les dents pour ne pas crier, tellement mes plantes de pieds me faisaient encore mal.
Notre apparition, après un mois d’absence au sein de cette triste et morne assemblée dont les rangs s’étaient encore éclaircis d’une bonne trentaine depuis mon départ Provoqua un mouvement quasi-général de stupeur, d’indignation, de colère. L’examen de détail dont je fus l’objet et dont les répercussions se lisaient dans les yeux de chacun me rassura quant à l’issue des débats. On y lisait la compassion, la pitié.
Walter, le moins coupable aux yeux du Chef de Camp, fut invité à parler le premier. Sortant son petit papier, il débita, dans son mauvaisfrançais, ses péchés et fit son mea-culpa en moins de dix minutes. Il s’accusa de toutes les exactions, exprima ensuite ses regrets qu’il voulait sincères, son repentir, pour finalement assurer solennellement à tout le monde qu’il allait consacrer le reste de sa captivité à racheter ses fautes. N’y croyant pas lui même cette autocritique était d’un grotesque ridicule, mais bien dans le style Camp 113.
Dès que Walter en eut terminé, je fus à mon tour convie a prendre la parole. Jamais je ne m’étais plié à de telles simagrées. J’avais toujours agi selon la conscience, pour le bien de tous, sans jamais me compromettre. Aussi j’étais décidé, quoiqu’il put m’arriver, à ne pas dévier de ma ligne de conduite.
Me redressant autant que mon état me le permettait, regardant tour à tour droit dans les yeux autorités et minorité méprisable groupée autour de son leader, je leur dis à peu près ceci
‘Militaire depuis bientôt 14 ans, on m’a toujours appris que le devoir de tout prisonnier était de tenter, par tous les moyens, de s’évader. Je n’ai fait que mon devoir. Je ne regrette rien, hormis la mort de mon ami et mon échec".
Ni BOUDAREL, ni le chef de camp n’ont bronché. Par contre, le clan des soumis était scandalisé par mes propos, outré par tant d’insolence. En vérité, ses membres avaient été surpris et profondément vexés de s’entendre rappeler leur devoir par l’un de ceux qui avaient toujours contrecarré leurs bas desseins.
Leur guide et mauvais génie, le faux-jeton R... prit la parole le premier. Souvent interrompu par les cris de réprobation de la majorité, tel un avocat général en cour d’assise, il tenta de prouver ma culpabilité. Pour lui, j’avais trahi la confiance des autorités, du bon peuple vietnamien, de l’ensemble de mes camarades. J’avais volé la population laborieuse en m’emparant d’embarcations, en chapardant grains de maïs, manioc, pousses de bambou et autres viatiques, j’étais demeuré ce que j’avais toujours été : un mercenaire des impérialistes, un ennemi du peuple. Il alla même jusqu’à me reprocher mon séjour dans les camps de représailles. A ses yeux il n’y avait pas de doute possible : j’étais coupable. Je devais être puni. A l’encontre de Walter, son opinion fut plus nuancée, ses accusations moins virulentes. Celui-ci s’était tout bonnement laissé entraîner. Il n’était d’ailleurs pas allé très loin. De plus, n’avait-il pas fait une autocritique ? En conséquence,, il était susceptible de bénéficier de circonstances atténuantes.
Le réquisitoire de l’adjudant R... fut approuvé et complété par quelques autres de ses amis.
Malgré mon expérience des camps, j’étais écoeuré par tant de lâcheté, par tant de bassesse. Chez certains, même, le sentiment de haine perçait.
Comment des soldats français étaient-ils parvenus à une telle déchéance ? Etait-ce l’action combinée de la sous-alimentation, entretenue par un jeûne continuel, des maladies, du climat, du travail forcé, des mauvaises conditions d’habitat, de la souffrance morale résultant de l’absence de nouvelles de la famille et du reste du monde, de l’absurdité du mode d’existence liée à l’épuisement et au dénuement le plus total, de la peur de mourir, de l’abêtissement créé par la répétition sous la contrainte des mêmes principes, des mêmes vérités, des slogans révolutionnaires ?
Certes, tous ces facteurs y avaient largement contribué, mais il y avait encore autre chose, puisque tout le monde n’était pas atteint au même degré. Outre l’absence de volonté, ces individus avaient perdu toute dignité. Tout leur était bon, y compris la condamnation à mort d’un camarade, dans le seul but de s’attirer les bonnes grâces des autorités, qui brandissaient sans cesse devant ces pauvres types, comme une carotte, la promesse illusoire d’une libération anticipée.
Au risque d’être classés comme je l’étais jusqu’à la fin de leur captivité dans la catégorie des ‘vipères lubriques" par les autorités, une vingtaine de mes camarades prirent franchement ma défense en termes énergiques, approuvés par la majorité silencieuse. Faisant état de l’image macabre que je présentais aux regards de tous, les uns évoquèrent les terribles souffrances physiques et morales que j’avais dû endurer, tant au cours de mon odyssée que depuis mon retour, la mort en l’espace d’une semaine des neuf autres camarades qui m’avaient précédé dans la prison constituant la preuve, les autres révélèrent la raison que personne n’ignorait mais que certains n’osaient pas dévoiler et qui m’avait incité à tenter l’évasion, que chacun, secrètement, aurait voulu soi-même tenter : c’était l’absurdité du mode de vie.
Ils n’omirent pas, également, de fustiger l’attitude de ceux qui, par dépit, par jalousie, par égoïsme, par méchanceté désiraient une mort de plus.
Ni le chef de camp, ni BOUDAREL n’étaient intervenus dans le débat. Us votes qui suivirent nous furent favorables. Pour Walter, il y eut presque unanimité ; pour moi, une trentaine de prisonniers votèrent pour mon maintien en prison. Ma réintégration dans la communauté fut cependant proclamée par le Chef de Camp aussitôt après le vote. Ce fut le moment que je choisis pour m’écrouler. Vaincu par la fatigue et l’émotion, j’étais resté plus d’une heure debout. Pris en charge par Kernen, je fus transporté par mes camarades de groupe dans notre cagna.
Une nouvelle page était tourné, la plus marquante, et le plus tragique épisode de ma vie de prisonnier s’achevait. Mes misères n’étaient pas terminées pour autant. Si je voulais vivre, il me fallait encore lutter pour guérir physiquement et moralement, chasser de mon esprit l’idée d’abandon qui, peu à peu, s’était emparée de moi.
J’aurais immédiatement voulu oublier la terrible aventure que je venais de vivre, mais il n’y avait rien à faire. Tout me la rappelait : son récit, trop souvent répété à mes camarades avides de détails et aussi d’émotions fortes, la mort de mon ami, notre échec alors que nous touchions au but, mes plaies et blessures, ma santé précaire, mes nerfs fatigués, mon état d’angoisse permanente, mes insomnies, mes cauchemars.
Intentionnellement ignoré des autorités, soigné par Kernen, dispensé des corvées pénibles en raison de ma faiblesse du moment, j’errais dans le camp, le plus souvent seul, seul avec mes pensées, seul avec mes souvenirs.
Je demeurai ainsi dans un état de semi-prostration, doutant de mes capacités à vaincre le désespoir qui m’accaparait, jusqu’au début du mois de septembre 1953, date à laquelle le Chef de Camp décida ou en reçut l’ordre d’expédier tous les adjudants et adjudants-chefs au Camp N’ 1 : camp des Officiers. Lors de mes adieux au Capitaine Thomasi, nous avions calculé le taux approximatif des décès au Camp 113 depuis mon arrivée. En cinq mois et demi, nous avions perdu près de 90 % des effectifs primitifs. Triste bilan !
http://archives.chez.com/evasion.htm
-
LE CAMP 113
Ce fut par étapes journalières successives de 15 à 20 kilomètres, marquées par de nombreuses haltes diarrhéiques que nous nous dirigeâmes vers le Camp 113.

Notre organisme affaibli et l’état lamentable de nos pieds ne nous permettaient, en aucun cas, de faire plus.

Nos deux gardes semblaient d’ailleurs l’avoir compris, ils nous laissaient toute latitude pour régler la marche à notre guise.
Ils avaient certainement dû recevoir des ordres dans ce sens avant notre départ, la consigne étant sans aucun doute de nous livrer en piteux état, certes, mais vivants au Chef du Camp 113.
Chaque soir, nous mangions et logions chez l’habitant.
Notre condition alimentaire s’était sensiblement améliorée, nous devions atteindre les 500 grammes de riz par jour, servis en deux repas, avec quelques légumes et parfois même de la viande de porc, suppléments toujours gracieusement offerts par les paysans qui nous hébergeaient.

récit, sobre et violent, de neuf mois d'enfer, d'une lutte quotidienne contre la mort, qui emportera près de deux détenus sur trois.
A la misère physique s'ajoute une misère morale peut-être pire encore.
En effet la rééduction politique est assurée par un Français, Boudarel, qui leur prodigue sans relâche la saine doctrine communiste jusqu'à la haine de soi et des autres.

Le ler mars 1953, nous touchions enfin au but, littéralement crevés", mais avec néanmoins une lueur d’espoir quant à l’amélioration prochaine de notre condition de vie.
Le dernier cours d’eau assez profond fut franchi "à poil", la tenue de combat enroulée autour du cou, sur la charge de riz, avec l’aide précieuse de nos deux bo-doï, nos anges gardiens depuis notre départ de Nghia-Lo.

A force d’habitude, ils nous étaient devenus presque sympathiques. Sur la rive opposée se dressait le Camp 113.
Le grand appentis abritant les cuisines se tenait aux abords immédiats de la rivière.
Le camp proprement dit, dont on apercevait les premières cagnas dissimulées sous la végétation, s élevait à 200 mètres de là.

Les premiers pensionnaires rencontrés, presque aussi mal en point que nous, ne furent guère curieux ni loquaces.
Etaient-ils blasés, ou bien respectaient-ils tout simplement notre misère et notre fatigue ? Les deux suppositions pouvaient être admises.
Dès notre arrivée, nous fûmes conduits chez le Chef de camp.
Homme sans âge, de taille moyenne, sec, comme la plupart de ses compatriotes, ni sympathique ni franchement antipathique, il nous souhaita la bienvenue en ces termes :
"Je suis heureux de vous accueillir au Camp 113.
Je sais tout de vous..

Mais quoi que vous ayiez pu faire avant votre capture, vous serez hébergés, nourris et soignés ici dans les mêmes conditions que vos camarades simples combattants selon les principes humanitaires prescrits par notre vénéré Président.
Cette mansuétude à votre égard ne devra toutefois pas vous faire oublier votre position de "criminel de guerre".

il vous faudra obéir sans discuter aux ordres des gardes, du surveillant général, de mon adjoint ici présent, français comme vous, mais qui depuis 1945
a choisi le camp de la paix".
Instinctivement, nous suivîmes le regard du Chef de camp pour tenter de distinguer les traits de celui qu’il venait de nommer.

Assis à l’écart, dans la pénombre, demeuré silencieux depuis notre entrée afin, vraisemblablement, de mieux nous observer, nous ne l’avions pas remarqué. Son image était trop floue pour nous permettre de le définir.
Le Chef de camp ne nous en laissa d’ailleurs pas le temps.
"Monsieur BOUDAREL, dit-il, est chargé, sous ma responsabilité, d’animer ce camp, c’est-à-dire d’assurer votre rééducation politique, d’organiser vos loisirs, de vous donner le goût du travail manuel afin de faire de vous, fils égarés d’un peuple travailleur, épris de liberté, des hommes nouveaux, des combattants de la paix.
Je compte sur votre concours et votre bonne volonté.
Maintenant, allez rejoindre vos camarades et vous reposer. J’ai donné les ordres nécessaires pour votre installation".
Nous venions d’entendre notre Nième leçon de morale socialiste.
En dépit du ton persuasif de la dernière phrase, elle n’avait, comme les précédentes, profité qu’à son auteur, entretenant chez lui, comme un besoin, l’illusion de sa médiocre importance.
Quant à son adjoint, il en fut pour ses frais.
Blasés à tout jamais par de tels propos, nous étions, mon camarade et moi, restés sans réaction. Sa manière de procéder, d’épier dans l’ombre pour le compte de nos ennemis, le comportement de ses malheureux compatriotes, qu’il allait, par sa trahison, contribuer à avilir, me le rendit d’emblée antipathique.
Une nouvelle de notre arrivée s’était très vite répandue. Aussi, dès mon apparition, je fus immédiatement assailli de questions. La plupart de mes camarades de combat étaient là, avides de nouvelles. Ils m’avaient d’ailleurs tous cru mort. Leurs visages maigres, leurs yeux enfoncés, leur teint bilieux m’ôtèrent une partie de mes illusions quant à une amélioration substantielle de ma condition de vie.

Toutefois, leur nombre, leur présence, leur sollicitude me réconfortèrent.
C’est la raison pour laquelle, pressé de questions, je leur fis, malgré ma lassitude, le récit détaillé de mes cinq longs mois d’internement éprouvant même, au fur et à mesure que je débitais mon long monologue, un impression de soulagement, comme si le simple fait de leur raconter ma récente misère pouvait la leur faire partager.
Mon adaptation au rythme du camp allait durer une dizaine de jours, au cours desquels, bénéficiant de la complicité de mon chef de groupe et de l’esprit de solidarité des hommes valides, je parvins à éviter la plupart des corvées.
Ce court répit me permit de récupérer un tant soit peu de mes forces et de soigner tant bien que mal mes plantes de pieds et chevilles avec l’aide et grâce au dévouement et à l’esprit inventif et débrouillard de Kemen, seul et unique infirmier du camp.
Ce laps de temps me donna également l’occasion de faire plus ample connaissance avec les lieux et d’étudier les hommes, leur comportement et leurs réactions face à leurs misérables conditions d’existence.
Le Camp 113 était bâti sur une sorte de promontoire boisé, mais débroussaillé, avec, en son milieu, une clairière artificielle aménagée en amphithéâtre, dans lequel des rondins posés directement sur des troncs d’arbres sectionnés faisaient office de bancs. Face à ces bancs, une estrade.
Délimitant cet amphi, sur ses côtés est et ouest s’élevaient deux rangées de cagnas, comportant chacune deux bâts-flancs et une allée centrale, dissimulées sous la frondaison.
Sur chacun des autres côtés aboutissait un chemin.
L’un descendait en un large virage à gauche vers les habitations des autorités et des gardes, puis, plus loin, vers les cuisines et la rivière, l’autre menait tout droit, en pente douce, vers la cagna baptisée "‘infirmerie".
Rien ne délimitait le camp, ni rideau de bambou ni clôture de barbelés ni mirador, c’était superflu. Tout autour de nous, c’était la jungle hostile, avec ses embûches, ses fauves, ses serpents, ses myriades d’insectes de toutes espèces.
Approximativement, nous situions le camp à 70 km de la frontière de Chine, à 20 km du grand village de Vinh-Thui (6) placé au point de jonction de notre cours d’eau avec la Rivière Claire, à 200 km de Tuyen-Quang, à 350 km de Vietri poste français le plus proche, à 450 km de Hanoï, à plus de 14-000 km de la France à vol d’oiseau.

Le camp était occupé par quelque 320 prisonniers, tous d’origine européenne, parmi lesquels 7 officiers attendaient depuis des mois leur transfert au Camp N’ 1, une trentaine de sous-officiers dont une dizaine d’adjudants-chefs et d’adjudants.
Sur ce nombre, 270 environ survivaient dans des conditions précaires d’alimentation, d’hygiène et de prophylaxie.
A l’infirmerie, véritable antichambre de la mort,
20 squelettes à pieds d’éléphant (7) agonisaient sous un essaim de grosses mouches vertes. Malgré le dévouement de Kemen et sa médication de fortune, ils étaient vaincus par la faim, vidés par la dysenterie, minés par le paludisme, l’avitaminose, les ascaris, la peau rongée par les champignons de la dartre annamite, de la bourbouille et du hong-kong-foot.

Parmi ceux qui n’avaient plus aucune réaction et qui allaient mourir le soir même ou dans la nuit, certains avaient les lobes d’oreilles et la base des narines entamés par les rats. C’était un spectacle affreux.
Dans les cagnas, le reste de l’effectif atteint des mêmes maladies, à un degré moindre peut-être, mais cependant d’une autre non moins mauvaise :
"la maladie du bât-flanc" (mauvaise habitude consistant à rester allongé en dehors des heures normales de repos), se préparait à remplacer, à plus ou moins brève échéance, à l’infirmerie, leurs camarades qui allaient mourir.
En somme, la hantise au camp était dominée par la hantise de la mort.
C’était un véritable mouvement continu, à sens unique, irréversibles Tous ceux qui étaient admis à l’infirmerie mouraient.
Les agonisants attendaient la mort, les épuisés prenaient la place des agonisants, les sans-espoir succédaient aux épuisés, les nouveaux arrivés comblaient les vides entretenant ainsi le cycle.
Le taux de mortalité variait entre 25 et 40 décès par mois, et même plus, selon les saisons.
La catégorie la plus touchée était, sans conteste, celle des jeunes de 18 à 25 ans, fait qui tendrait à confirmer que l’homme n’atteint son point de maturité qu’à 25 ans. Autre constatation : les célibataires tenaient moins bien le coup que les mariés. Là encore, je pense qu’un facteur stimulant intervenait pour maintenir à un niveau plus élevé le moral et la volonté de survie de l’homme marié : sa responsabilité de chef de famille.
Dans un but d’organisation, les pensionnaires étaient répartis par groupes de 30 à 40. Le responsable du groupe ou animateur était élu par ses camarades. Son investiture restait toutefois subordonnée à l’approbation du Chef de camp, ou plutôt de son adjoint, BOUDAREL, le "théoricien", qui en sa qualité d’ex-professeur de philosophie au lycée de Saigon, était plus apte à jauger les hommes, d’autant plus que ceux-ci étaient ses compatriotes.
L’animateur avait des responsabilités très limitées.
Il veillait au maintien de la propreté des locaux communs, à l’observation de l’hygiène collective dans la mesure des moyens (inexistants), procédait aux appels sous la tutelle d’un garde ou du surveillant général, dirigeait l’activité du.
groupe en matière d’éducation politique et de loisirs, participait avec ses pairs à la rédaction des motions, manifestes ou lettres.
Du lot des animateurs émergeait l’Adjudant R.... beau parleur, à la réplique facile, doté d’une conscience élastique lui permettant de s’adapter à toutes les situations en profitant de toutes les circonstances pour arriver à ses fins, même s’il devait pour cela user de procédés peu recommandables tels que le mouchardage et les fausses accusations. Sa façon de louvoyer, d’aller au-devant des désirs des autorités et de les satisfaire au-delà de leurs espérances, son goût très marqué, pour les idées professées dans les cours politiques qu’il animait par ses initiatives hardies et ses prises de position catégoriques, toujours bien accueillies par BOUDAREL, lui conféraient une certaine notoriété. Celle-ci lui donnait de l’ascendant sur un petit noyau de prisonniers sans envergure ni personnalité (sous-officiers pour la plupart), qui préféraient cette solution de facilité consistant à abonder dans ses idées et se placer sous sa protection, pensant de cette manière pouvoir s’attirer les bonnes grâces de leurs geôliers.
Ainsi se présentait à moi le Camp 113, avant mon intégration complète en son sein.
Quoiqu’il en fut, le sentiment de sécurité que procurait la masse de mes compagnons d’infortune, la chaleur des amitiés retrouvées, la création de nouvelles, notamment parmi mes compatriotes bretons me libérèrent progressivement de l’angoisse incessante ressentie au cours de mes cinq premiers mois d’internement.
C’est pourquoi, malgré ma fatigue persistante, la faim, les plaies incomplètement guéries, la dysenterie qui me sciait les tripes, les accès de palu de plus en plus fréquents, le béri-béri, je retrouvai peu à peu mon calme.
Ma volonté de vivre, un instant ébranlée, reprenait le dessus.
"Criminels de guerre, vous êtes ici pour expier vos fautes, vos crimes!", c’était l’éternel refrain.
Le système de rééducation imposé aux prisonniers était axé tout entier vers ce but. Le vieil homme devait faire place à un homme nouveau.
Les mercenaires sanguinaires du capitalisme international devaient se transformer en véritables et agissants combattants de la paix, selon le procédé marxiste, le seul valable, qui consistait à affamer les corps (c’était chose faite) pour disposer plus facilement des esprits (ce qui fut plus difficile).
Notre emploi du temps s’établissait, en principe, de la manière suivante: Les matinées étaient consacrées aux corvées courtes, corvée de bois, lessive, débroussaillage, etc. La corvée de bois avait lieu tous les jours (le bambou brûle vite), la corvée de riz tous les dix jours environ (distance variable, 15 à 25 km). L2 corvée de sel (30 à 40 km), de loin la plus pénible, la plus harassante, le plus souvent conduite par BOUDAREL, durait deux, trois et parfois même quatre jours. L’équipe qui y participait perdait à chaque fois deux, trois ou quatre hommes en cours de route ou après le retour au camp, un nombre analogue un ou deux jours plus tard. Les après-midi étaient consacrées à l’éducation politique par BOUDAREL, aux séances d’autocritique, auxquelles je ne me suis jamais plié, n’ayant rien à me reprocher. Mais il n’en était pas de même de nombreux autres camarades, qui s’accusaient d’exactions invraisemblables, puis juraient sur leurs grands dieux qu’ils allaient passer le reste de leur captivité à s’amender, à se repentir dans le but avoué d’entrer dans les bonnes grâces de leur laveur de cerveau, avec l’espoir de faire partie de la prochaine libération anticipée. Les meetings coîncidaient avec les bonnes nouvelles du front ou les exploits des stakhanovistes russes. Les soirées étaient meublées soit par des veillées au cours desquelles alternaient chants et sketchs, soit par des discussions au sein des groupes.
Tous ceux qui pouvaient tenir debout participaient aux corvées et aux activités du camp. "Si pas travailler, c’est pas manger telle était la devise du surveillant général.
Notre bonne ou mauvaise volonté à admettre la vérité enseignée conditionnait tout le système. C’est pourquoi, les lendemains des cours ou meetings sans résultats satisfaisants, on voyait s’allonger la corvée de bois de 4 à 5 km, la corvée de riz de 10 à 20 km. Pour la même raison, la quantité de riz aux repas diminuait, le cube de viande de buffle disparaissait bientôt du menu sous prétexte de pénurie momentanée. Par contre, lorsque des progrès étaient constatés dans notre éducation, le phénomène inverse se produisait. Dans ces moments-là - ils étaient rares - les autorités auraient facilement sacrifié deux ou trois chèvres. Bref, comme notre estomac, le système était élastique.
Bien que supérieure de 200 à 250 grammes à celle servie dans les camps de représailles et qui m’avait fait perdre 20 kilos en cinq mois, la ration alimentaire quotidienne était nettement insuffisante pour maintenir les corps, déjà vidés de leur substance, en état de résister aux fatigues journalières, aux maladies, à la rigueur du climat.
Cette ration représentait une certaine quantité de denrées alimentaires correspondant à la valeur en piastres "Ho-Chi-Minh" d’un kilo de riz. Ce qui ne voulait pas dire que chaque prisonnier percevait un kilo de riz par jour. C’était plus subtil et plus compliqué que cela. Théoriquement - je dis bien théoriquement - la ration homme-jour se- décomposait comme suit
Riz = 600 g
Sel = 5 à 10 g
(perceptions très irrégulières, souvent un mois sans)
Viande = 10 à 20 g de viande de buffle
Légumes = pratiquement inexistants, à part une fois de temps en temps, 1 des liserons d’eau, des racines de manioc, des feuilles de courges, des herbes comestibles.
Le kilo de riz étant taxé à 20 piastres, la ration homme-jour de riz représentait déjà, à elle seule (20 X 600) : 1000 = 12 piastres. L’équivalent en piastres des 400 g restants, soit (20 - 12) = 8 piastres était utilisé pour l’achat, à l’intendance ou chez l’habitant, des autres denrées. Le sel, élément de soutien indispensable à l’organisme, en particulier dans les pays tropicaux, où l’on transpire tellement, était une denrée très rare. Importé de Chine, ou provenant du delta par voie de contrebande, il était hors de prix. En somme, il ne restait même plus 8 piastres pour acheter la viande et les légumes. Même en tablant sur 8 piastres, chaque prisonnier ne pouvait, en dehors des vieux buffles prêts à crever, espérer journellement et raisonnablement prétendre qu’à quelques grammes.
En admettant que la totalité du riz absorbé fut assimilée par l’organisme, ce qui reste à vérifier, cette ration de famine fournissait à chaque prisonnier un maximum de 2.000 calories par jour alors qu’il lui en aurait fallu 4.000 pour se maintenir en condition en raison de ses activités et de la rigueur du climat, qui le créaient parmi les travailleurs de force de 2ème catégorie.
Mieux qu’un long exposé, le tableau comparatif joint en annexe montre d’une manière saisissante les déficits en calories et principes énergétiques de la ration alimentaire servie aux prisonniers de guerre dans les camps du Viet-Minh par rapport aux besoins normaux d’un travailleur de même condition.
Ainsi, donc, pour rétablir l’équilibre entre la quantité de calories reçues (2.000) et la quantité de calories dépensées (4.000), le prisonnier devait chaque jour puiser dans ses propres réserves les 2.000 calories manquantes. Durant les premiers mois de la captivité, ce processus de restitution par l’organisme d’une quantité d’énergie "travail" supérieure à la quantité d’énergie aliment" reçue se concevait, mais plus après six ou neuf mois de détention. En effet, passé ce délai, il ne restait plus un gramme de graisse à brûler dans les organismes décharnés des prisonniers. C’est la raison pour laquelle, passé ce délai, la plupart mouraient.
Mais alors, me direz-vous, comment les autres ont-ils fait pour survivre ? Là est l’énigme ! D’autres avant nous ont vécu dans des conditions non pas analogues, mais comparables : ce sont les détenus des camps de concentration nazis. Eh bien, malgré l’effroyable hécatombe, quelques-uns ont survécu. Ceux qui avaient la foi, un idéal ou une responsabilité familiale capables de garder intact leur moral. Je pense qu’il en a été de même pour les survivants des camps du Viet-Minh.
Le mois de juin 1953 fut fertile en événements. Vers le 5 du mois, une vingtaine de prisonniers, sélectionnés parmi les plus évolués politiquement, furent dirigés vers les lignes françaises en vue de leur libération. Comme il y avait peu d’élus, il y eut beaucoup de déçus, en particulier dans le clan des mouchards et rampants notoires, dont le chef spirituel riait jaune. Parmi les élus, deux réintégrèrent le camp après trois semaines d’absence. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’au dernier moment, juste à la minute où ils croyaient le miracle accompli, leur directeur de conscience (le commissaire politique) leur avait signifié qu’il leur manquait encore un petit quelque chose, en matière de rééducation, pour être digne de bénéficier de la clémence du président Ho. En vérité, tout était prévu dès leur départ du camp, c’était dans la ligne du système. Quel terrible choc moral pour ces deux pauvres types ! Certains camarades furent à maintes reprises les victimes de ce jeu cruel.
Pour ceux qui restaient, cette libération eut toutefois une conséquence heureuse. En effet, par l’intermédiaire de nos camarades libérés et des autorités militaires françaises qui les avaient accueillis, nos familles allaient enfin savoir ce que nous étions devenus, être fixées sur notre sort. Il n’avait certes pas été question de remettre de lettres à ceux qui étaient partis, une telle pratique était strictement interdite et bien trop risquée pour le prisonnier qui avait eu la chance de quitter le camp. A propos de nouvelles, je signale que la dernière lettre adressée à ma femme remontait au 14 octobre 1952. Depuis, plus rien, hormis le bref communiqué habituel des autorités militaires "porté disparu, présumé prisonnier !" que le maire de Morlaix avait eu la pénible mission de transmettre. Depuis ma capture, je songeais souvent à la terrible angoisse dans laquelle ma famille vivait, sans nouvelles depuis huit mois, ne sachant même pas si j’étais encore de ce monde. En ce mois de juin 1953, beaucoup de familles eurent hélas à déplorer la mort d’un des leurs, et déjà la très longue liste s’allongeait tous les jours. Tous nous redoutions l’issue fatale.
La recrudescence de la mortalité, en ce début de mois, maintenait cet état d’esprit. La chaleur étouffante annonciatrice de la mousson y était pour une grande part responsable. On enterrait à tour de bras un, deux, trois, quatre par jour et parfois plus. L’équipe des croque-morts du Capitaine Thomasi, chargée de creuser les tombes, ne suffisait plus, on dut la renforcer.
L’infirmerie, où les condamnés à mort ne faisaient que passer, était pleine d’hommes nus, squelettiques, complètement déshydratés, qui n’avaient même plus la force ou la volonté ni de manger, ni de se lever pour satisfaire leurs besoins naturels. Leur immobilité cadavérique, pouvait-on dire, ne permettait quelquefois pas, à première vue, de distinguer ceux qui venaient de mourir des moribonds. Il n’y avait cependant pas besoin de tâter le pouls ou le coeur pour constater la mort. En effet, dès que l’âme avait quitté le corps de celui qu’allait pourrir en terre du Viet-Nam, les ascaris se montraient, fuyant par l’anus ou par la bouche les intestins ou l’estomac de celui qu’ils avaient patiemment mais inexorablement aidé à mourir.
Ascaris, excréments, mouches, asticots souillaient en permanence les bât-flancs de cette morgue-infirmerie où, inlassable, Kemen, aidé depuis peu par deux camarades, faisait tout ce qui était en son pouvoir pour soulager les souffrances et maintenir un semblant d’hygiène. Son dévouement faisait l’admiration de tous. Comment faisait-il pour ne pas céder au découragement devant l’inutilité de ses efforts devant la carence des autorités responsables qui ne lâchaient leurs comprimés de paludrine, d’opium ou de stovarsol qu’au compte-gouttes ? Certes, l’amour de son métier y était pour quelque chose, mais il y avait aussi - et surtout - son esprit de solidarité. Ce n’étaient certainement pas les mêmes sentiments qui animaient l’intellectuel BOUDAREL, "Eminence Rouge" du camp pour se faire le complice agissant de cette entreprise de destruction massive de compatriotes. Le comportement de cet homme était incompréhensible ; son indifférence dépassait l’imagination. L’idéologie marxiste avait dû lui mettre une pierre à la place du coeur.
Un membre de l’équipe des cuistots ayant été libéré, je fus dès son départ appelé à le remplacer. Je ne m’attendais pas du tout à cette affectation. Elle ne me réjouissait pas. C’était un poste à très grande responsabilité compte tenu des maigres rations mises à notre disposition pour la distribution. Si pour le riz la répartition était relativement facile, il n’en était pas du tout de même pour la viande. Diviser 6 kilos de viande en 300 parts égales n’était pas, je vous l’avoue, chose aisée. Il ne fallait pourtant léser personne, c’eût été impardonnable, surtout en cette période de mortalité jamais égalée. Pour la viande, il fallait encore tenir compte de la chaleur. Crue, elle ne se conservait qu’un jour ; cuite, trois jours au maximum, et encore fallait-il la recouvrir d’une bonne couche de graisse pour éviter tout contact avec l’air chaud ambiant et les mouches. J’aurais bien volontiers cédé mon poste à l’Adjudant R.., patron des soumis, qui paraissait jalouser ma place, s’il n’avait tenu qu’à moi de prendre cette décision.
Vers le 30 juin, nous reçûmes la visite d’un avion d’observation français : les libérés avaient bien situé le camp aux autorités militaires françaises. Avec notre complicité, il repéra le camp dès le premier passage. Le lendemain, un Dakota de la Croix-Rouge nous parachutait vivres, médicaments et certainement courrier. Nous n’en vîmes pas la couleur. La plus grande partie fut récupérée par l’armée populaire, le reste par le Chef de camp et ses adjoints. Kemen reçut, en plusieurs fois, quelques boîtes de lait concentré, quelques comprimés supplémentaires que, la mort dans l’âme, il ne fut autorisé à administrer qu’aux mourants - à ceux qui n’en avaient plus besoin - parce que, chez eux, le point de non-retour était atteint ou déjà franchi. Quel gâchis !
La situation sanitaire se dégradait de jour en jour, et l’affaiblissement général et progressif des individus à la fin de juin laissait présager le pire. On voyait des prisonniers, apparemment bien portants la veille ou l’avant-veille, mourir subitement. Les rats, qui proliféraient à une cadence prodigieuse, furent rendus responsables de ces décès subits et rapides. Dans une certaine mesure cette accusation était justifiée, des cas analogues s’étant déjà présentés dans d’autres camps, où la spirochétose, maladie provoquée par une bactérie transmise par les urines du rat avait fait des ravages. Pour tenter d’en réduire les causes et les effets, une chasse aux rats fut immédiatement organisée. En quelques jours, une bonne centaine de ces rongeurs passa de vie à trépas. La cadence des décès ne ralentit pas pour autant.
Jusqu’à cette date, la mort n’avait touché que des hommes de troupe et quelques sous-officiers, dont la valeur marchande, pour les Viets, n’avait que peu d’importance, mais elle pouvait bientôt, sans crier gare, frapper les quelques officiers encore présents au camp, au sort desquels la Croix-Rouge Internationale s’intéressait. Leur disparition risquait de soulever des problèmes, notamment à l’heure des règlements de comptes à la fin de la guerre, lors de l’échange des prisonniers. Il devenait donc urgent de les soustraire au plus vite au danger immédiat. Les autorités agirent sans retard, à l’exception du Capitaine Thomasi, dont les raisons du maintien nous échappaient. Ils furent dès les premiers jours de juillet mis en route sur le Camp, N’ 1.
Devant la recrudescence de la mortalité, chacun réagit selon sa dose de volonté du moment. Un grand nombre de prisonniers s’abandonna au désespoir, malgré les efforts des plus valides pour les inciter à réagir. L’hygiène individuelle et collective se relâcha à un point tel que l’emploi de la force devint nécessaire pour obliger certains camarades à prendre leur bain quotidien, à laver et bouillir leur tenue de paysan, seul et unique vêtement, à ébouillanter leur panier à riz et ké-bat à goyave, à bouillir leur eau de boisson, à nettoyer leur bât-flanc, à se rendre aux feuillées pour faire leur chiasse, et à manger la totalité de leur maigre ration de riz.
Personnellement, ma conscience et mon moral furent mis à rude épreuve. Je supputais mes chances de survie : elles étaient minimes.
Ex criminel de guerre dangereux, imperméable aux cours politiques, il était illusoire, pour moi, de compter sur la faveur d’une libération anticipée.
La guerre durait depuis 8 ans, elle pouvait encore durer autant, peut-être même plus. Nous ne connaissions, de la situation militaire, que les communiqués de victoire du Viet-Minh ; ils ne me convainquaient guère.
C’est devant tant d’incertitudes que germa peu à peu dans mon esprit l’idée d’une évasion. Les risques étaient énormes, mais en cette période, l’une des plus misérables que j’aie connues, l’évasion me paraissait être la seule issue possible. Mieux valait mourir dignement, en tentant l’impossible, plutôt que de mourir de maladie, ou tout simplement d’inanition dans ce camp de concentration du bout du monde.
Le poste français le plus proche, Vietri, au confluent du Fleuve Rouge et de la Rivière Claire était à quelque 350 km. Tenter l’aventure, à pied (pieds nus) par les pistes à travers la jungle, sans carte ni boussole ni guide ni vivres de réserve eût été de la folie.
Même en empruntant le chemin le plus court, la route coloniale, ce qui était impensable, il aurait fallu plus de 15 jours à un homme valide pour le faire.
La descente en barque ou en radeau de la rivière restait donc la seule et unique solution. C’était le début de la mousson. Il pleuvait tous les jours. Le niveau du cours d’eau qui arrosait le camp avait monté de près de trois mètres en moins de dix jours. La vitesse du courant était de l’ordre de 10 à 15 km à l’heure.
Malgré la mise en garde des autorités contre les dangers d’une telle tentative qui obligatoirement comportait la descente de la Rivière Claire, réputée pour la traîtrise de son cours, ses récifs à fleur d’eau, ses rapides et ses tourbillons, il convenait de profiter des circonstances favorables.
Tenter seul l’aventure sur un radeau eût été également courir au suicide. Seul, je n’aurais jamais pu le guider, le maintenir dans le sens du courant. Je devais donc chercher un partenaire sûr et qui voulut bien affronter et partager tous les risques et périls que cette folle tentative comportait.
L’adjudant Montagne fut ce partenaire. Ancien du Bataillon de Corée, nous avions fait la traversée de Marseille - Haïphong ensemble et sympathisé dès le départ.
Affectés tous deux au ler Bataillon Thaï, lui à la 4ème Compagnie, unité qui tenait le piton surplombant Nghia-Lo, moi à la C.C.B, nous nous étions revus très souvent avant notre capture. A mon arrivée au Camp 113, il fut le premier à m’accueillir et à me réconforter. Militaire cent pour cent, marié, père de famille, il partageait mes sentiments quant à nos chances de survie ; c’est pourquoi il accepta d’emblée ma proposition, et cela d’autant plus facilement qu’il y avait lui-même songé.
Les préparatifs furent vite bâclés.
Radeau et pagaies furent repérés à deux kilomètres en aval du camp, au cours d’une corvée de bois.
Notre projet, tenu secret jusqu’au dernier moment, ne fut révélé qu’au Capitaine Thomasi et à Kemen, qui nous fournit quelques comprimés de’ paludrine et de sel, ainsi qu’une boule de riz de réserve, prélevée sur la ration des morts de la journée. Le départ fut fixé au 14 juillet, après l’appel du soir.
-
Les Français en Indochine, des années 1830 à la fin de la deuxième guerre mondialeProfesseur à l'université de Paris VIII

Historiquement, l'Indochine est le nom donné, à partir de 1888, à la réunion sous une administration unique, des colonies et protectorats français de la péninsule indochinoise qu'étaient les Cochinchine orientale et occidentale, le Cambodge, l'Annam et le Tonkin conquis entre 1862 et 1888, auxquels est adjoint le Laos en 1893. Après une phase de conquête où se distinguèrent missionnaires, officiers et géographes, la politique coloniale française en Indochine vit s'illustrer des hommes politiques comme Jules Ferry, Paul Bert, Paul Doumer ou Albert Sarraut. Lourde fiscalité et pression administrative furent à l'origine de troubles, avant que la montée du nationalisme annamite, la seconde guerre mondiale et l'intervention du Japon ne mettent fin à un siècle de présence française.
Gia Long, un empereur francophile
Les raisons de la présence française en Indochine sont multiples. On sait que l'aventure militaire du Siam, sous Louis XIV, s'est terminée par un échec. À la suite d'un certain nombre de maladresses, ce pays rompt tout contact avec les Européens après 1687. Il faut attendre un siècle pour assister au renouvellement d'une tentative du même ordre, cette fois au « royaume de Cochinchine », une composante de l'empire du Dai-Viêt, l'actuel Vietnam. Le 28 novembre 1787 en effet, Mgr Pigneaux de Béhaine, évêque in partibus d'Adran, fait signer à Louis XVI un « petit traité de Versailles » qui prévoyait le soutien au prince Nguyên Anh contre deux points d'appui sur la côte et au large du Vietnam, Tourane et Poulo-Condor, ainsi que le monopole du commerce. En fait, le soutien français fut presque inexistant, mais Mgr Pigneaux utilisa ses propres ressources et le soutien des négociants de l'île de France et de Pondichéry pour obtenir trois navires et un petit corps de troupe. Sur place, les « engagés volontaires » réussissent à moderniser la flotte et l'armée du prince Nguyên, qui remporte la victoire sur ses ennemis, les Tây-Son, et unifie le Vietnam sous le « nom de règne » de Gia Long.
En quoi la France peut-elle, à la fin du XVIIIe siècle, se trouver intéressée par l'Indochine ? Il semble que l'une des raisons essentielles ait été de contrebalancer, en Extrême-Orient, l'empire des Indes conquis par l'Angleterre de 1757 à 1856. La France, après les traités de 1763 puis 1814, ne conserve que cinq comptoirs sans possibilité militaire, sans arrière-pays et sans avenir. De leur côté, les Anglais occupent des points stratégiques : Ceylan en 1813, Singapour en 1819. Les États d'Extrême-Orient, par rapport à l'Inde, se sont entrouverts aux Européens au cours du XVIIe siècle, laissant deviner de surprenantes possibilités, puis se sont fermés de manière plus ou moins hermétique. Ce schéma est à peu près le même au Japon, au Siam, en Chine, au Dai-Viêt.
Dans ce dernier pays toutefois, Gia Long reste favorable à la France jusqu'à sa mort, en 1820. Il était très attaché à Mgr Pigneaux, dont la mort est entourée d'honneurs en 1799, et a su conserver à son service les « engagés volontaires », en particulier Chaigneau et Vannier, devenus mandarins dans un Vietnam réunifié que les Français appellent l'« empire d'Annam ». En 1820, après un voyage en France, Chaigneau regagne Hué avec un double titre de consul et commissaire du roi Louis XVIII, afin de négocier un nouveau traité de commerce. Mais à son retour, Gia Long n'est plus ; et son successeur, le prince Dam devenu Minh Mang, est beaucoup moins favorable à l'Occident. En dépit des efforts, l'Annam demeure fermé jusqu'au retour offensif des Français, en 1858.
La phase de conquête et d'exploration, 1859-1868
Les positions françaises en Extrême-Orient restent donc très limitées, surtout si on les compare aux positions anglaises qui se sont développées à partir du commerce de l'opium contre le thé. À Canton, au temps du principal conflit lié à l'opium (1839-1842), les seuls Français présents sont le consul et une poignée de prêtres lazaristes. Le prétexte à une intervention militaire est donné par quelques incidents symboliques mettant en cause les propagateurs de l'Évangile : meurtre d'un missionnaire français en Chine, massacre de chrétiens au Vietnam. En 1858, l'amiral Rigault de Genouilly fait une démonstration sur les côtes de Chine puis va exiger réparation de Tu Duc, alors empereur d'Annam.
Le corps expéditionnaire français s'empare de Tourane, aujourd'hui Da Nang sur le littoral annamite, pour se rendre compte aussitôt qu'il est presque impossible de gagner Hué, aussi bien par la rivière que par la voie de terre. En fait, on s'était fié un peu trop aux rapports lénifiants des missionnaires ; les officiers découvrent là une population et des mandarins hostiles, ainsi que des forces militaires plus importantes que prévu. Cherchant un meilleur point d'appui, Rigault de Genouilly finit par prendre Saigon le 17 février 1859. Mais la flotte française doit alors se lancer dans une opération contre Pékin, conjointement avec les Anglais. Cette expédition se fait avant que Tu Duc ait accepté de négocier ; un petit détachement est laissé à Saigon tandis que Tourane est évacuée.
À la fin des opérations contre la Chine, l'amiral Charner dégage Saigon en 1860 et occupe My tho et Biên Hoa, c'est-à-dire la plus grande partie de la basse Cochinchine. En février 1861, les « canonnières » à faible tirant d'eau poursuivent les embarcations annamites dans le dédale des innombrables bras du delta. En avril 1863, Tu Duc doit signer le traité de Hué, qui l'amène à céder les trois provinces de Saigon, My Tho et Biên Hoa à la France. Par ailleurs, il garantit le libre exercice du culte catholique en Annam. En France, l'opposition à la présence en Indochine est vive lorsque l'opinion publique sait que ces trois provinces sont données en pleine propriété. En effet, la France se trouve alors engagée et la guerre menée contre Tu Duc a coûté cent quarante millions de francs en trois ans. Les amiraux qui, depuis 1861, portent le titre de gouverneurs, réussissent pourtant à sauver leur conquête et à conserver le traité de Hué. Par ailleurs le roi du Cambodge, Norodom, décide de se placer sous protectorat français le 11 août 1863 ; ce faisant, il échappe ainsi à la tutelle du Siam, son puissant voisin. Ce nouvel épisode amène Tu Duc à céder à la France le reste de la Cochinchine : les provinces de Vinh Long, Hâ Tien et Chau Doc, entre Saigon et le territoire cambodgien. La dernière poche de résistance est celle que contrôle le mandarin Phan Than Gian, vice-roi du Bas-Mékong : il se suicide en 1867 après avoir conseillé la soumission.
C'est la recherche de points d'appui qui a mené la France à ce début de domination territoriale ; il reste, dans les années qui suivent 1860, à montrer l'utilité de la possession. Chasseloup-Laubat, président de la Société de Géographie, réclame l'exploration des plateaux laotiens. L'amiral La Grandière est persuadé que la nouvelle colonie offre une voie d'accès à la Chine et au commerce que l'on convoite depuis les débuts de l'époque moderne. C'est dans cette optique qu'il demande à Doudart de Lagrée (1823-1868), officier de marine qui s'est illustré au Cambodge, de remonter l'ensemble du Mékong. La voie a été partiellement ouverte par le journaliste Henri Mouhot, du Tour du Monde : ce dernier a visité les ruines d'Angkor, puis a atteint Luang Prabang, au Laos, où il est mort d'épuisement ; ses notes de voyage sont publiées par la revue. Fasciné par Angkor, Doudart a interrogé des bonzes au cours de l'année 1863, a traduit la Chronique royale du Cambodge, et pour finir découvre les origines indiennes de ce « royaume hindouisé ». En 1866, Doudart entreprend la remontée du Mékong à partir de Saigon et se rend vite compte au cours de sa progression vers le nord que le Mékong présente des difficultés d'ordre naturel presque insurmontables : les rapides de Kratié, à 500 km de l'embouchure, et d'ordre politique : de multiples petites principautés réclament des droits de passage et multiplient les difficultés à l'endroit des explorateurs. En fait, la véritable voie d'accès au Yunnan et à la Chine serait le Sông Koi, le fleuve Rouge. C'est en tentant de reconnaître cette voie que meurt Doudart de Lagrée, le 12 mars 1868. Son second, Francis Garnier, auteur de La Cochinchine française en 1864, termine l'expédition par le Yangzi et Shanghai et rentre à Saigon en juin 1868 avec une ample moisson de données géographiques et ethnographiques. Cette période de reconnaissance se termine avec les cinq voyages du docteur Harmand, effectués entre 1875 et 1877 au sud-ouest des grands lacs du Cambodge et vers le Laos où il découvre les populations « montagnardes » : Moïs, Khas, Thays.
La constitution territoriale de l'Indochine française
Les amiraux ont d'abord craint que la défaite de 1870 n'entraînât l'abandon de la colonie ; en 1872, la marine doit effectivement affronter une sévère réduction de son budget ; mais l'expansion se maintient toutefois, soutenue tant par les marins que par certains milieux d'affaires et les missionnaires, dont la revue Les Missions catholiques touche alors un vaste public. Il est vrai que l'intérêt se tourne désormais vers le fleuve Rouge et son bassin alluvial, le Tonkin, partie nord de l'« empire d'Annam ». La voie du fleuve Rouge est bien connue de Jean Dupuis, un aventurier qui achemine par là des armes destinées à un général chinois en 1872-1873, en principe pour mettre fin aux révoltes qui agitent le Yunnan. Ce trafic indispose Tu Duc, dont l'autorité sur le Tonkin se trouve bafouée. L'empereur exige du gouverneur de la Cochinchine, Dupré, qu'il mette un terme aux agissements de Dupuis. Mais ce dernier s'en remet également au gouverneur, demandant à la France la protection du commerce.
Dupré décide alors d'envoyer Francis Garnier, bon connaisseur, au Tonkin. En fait, Tu Duc avait peur que les agissements de Dupuis et d'autres aventuriers français n'encouragent l'opposition à la dynastie des Nguyên : celle des chrétiens, qui sont alors cent quarante mille au seul Tonkin ; celle des populations montagnardes et allogènes ; éventuellement, celle des descendants des anciennes dynasties rivales. Garnier réussit à s'emparer des principales places du delta, mais les troupes annamites réussissent à se regrouper et se renforcent des « Pavillons noirs », mercenaires chinois hostiles aux Européens qui encerclent Hanoi et tuent Francis Garnier lors d'une sortie, en 1873. Mais Dupré désavoue officiellement l'aventure de Garnier, et envoie Louis Philastre, un lieutenant de vaisseau, négocier près de Tu Duc à Hué. Philastre accepte l'évacuation du Tonkin, ce qui suppose l'abandon des chrétiens : en mars 1874, par une convention signée à Saigon, la France reconnaît l'indépendance et la souveraineté de l'empire d'Annam. En échange, Tu Duc promet d'ouvrir au commerce international trois ports du Tonkin et le fleuve Rouge.
C'était là une importante modification des positions françaises. Elle change avec l'arrivée des républicains à Paris ; en juillet 1881, le gouvernement Ferry obtient des chambres un crédit de 2,5 millions de francs pour une expédition sur le fleuve Rouge, pour lutter contre les pirates chinois officiellement. À la tête de cinq cents hommes, Francis Rivière s'empare de la citadelle d'Hanoi le 25 avril 1882 ; mais il est tué l'année suivante par les Pavillons noirs. En février 1883, Jules Ferry donne une nouvelle impulsion à la politique française en Extrême-Orient : le corps expéditionnaire est porté à quatre mille, puis neuf mille hommes. Une escadre, placée sous les ordres de l'amiral Courbet, est envoyée en mer de Chine tandis que survient la mort de Tu Duc, en août 1883. La cour de Hué se trouve obligée d'accepter un traité de protectorat qui lui impose la présence d'un résident français. Désormais, les deux anciens royaumes indépendants qu'étaient le Tonkin et la Cochinchine et qui avaient été réunis sous Gia Long se trouvent de nouveau séparés ; le terme d'Annam ne désigne plus que la partie centrale de l'empire démembré, de part et d'autre de Hué. À la fin de 1883 et au début de 1884, le corps expéditionnaire français s'empare de la plupart des points clés du delta du fleuve Rouge.
Il reste alors à résoudre le délicat problème des relations avec la Chine. Cette dernière, en dépit de son antique volonté de suzeraineté sur le Vietnam, reconnaît le protectorat français sur son voisin par la convention de Tien Tsin, signée le 11 mai 1884. Ce traité prévoit le retrait de toutes les troupes chinoises stationnées au Tonkin ; les opérations de retrait se font très lentement, et un incident survenu à Bac Lê, le 15 juin 1884, entraîne la rupture, bientôt suivie de la destruction d'une partie de la flotte chinoise à Fuzhou (Fou Tchéou), par Courbet, le 23 juillet de cette même année 1884. L'année suivante, un autre incident, grossi par la presse parisienne, entraîne un mouvement d'opinion hostile à la colonisation du Tonkin : il s'agit de l'évacuation par les Français du poste de Lang Son, à la frontière chinoise. Les radicaux, menés par Clemenceau, se déchaînent contre les abus de la guerre coloniale et finissent par obtenir la chute du gouvernement Ferry. La nouvelle chambre ne fait cependant pas évacuer le Tonkin, mais continue à voter les crédits à une faible majorité.
Paris décide alors d'envoyer un nouveau résident général en Annam : il s'agit de Paul Bert, physiologiste de renom, athée militant et promoteur de l'école laïque. À Hué, après la fuite du jeune empereur Ham Nghi, les Français ont intronisé un souverain à leur dévotion, en juillet 1885. En novembre 1886, Paul Bert meurt peu après son entrée en fonctions, tandis que fait rage une forme de guérilla anti-coloniale, l' «insurrection des lettrés » ou Cam Vuong, qui devient permanente dans la cordillère Annamitique et les forêts qui entourent le delta du fleuve Rouge ; elle aboutit au massacre d'environ quarante mille chrétiens sur les cent quarante mille que comptait alors le Tonkin. Ces « lettrés » sont des mandarins fidèles à la dynastie, ou des aventuriers qui s'octroient ce titre, et protègent le jeune Ham Nghi jusqu'à sa capture par les Français en 1888. Ils sont soutenus par les « pirates » ou mercenaires chinois qui se répartissent en Pavillons noirs, Pavillons jaunes, Pavillons rouges…
La « pacification » du delta du Tonkin n'est pas achevée avant 1891. Les régions montagneuses du haut Tonkin, toujours suspectes, sont partagées en quatre territoires militaires ; c'est à la tête du deuxième territoire, celui de Lang Son, que le colonel Gallieni, disciple de Lyautey, expérimente la méthode de la « tache d'huile », distribuant des armes aux villageois afin qu'ils organisent eux-mêmes leur défense contre les Pavillons noirs. Dans ces régions, la fin de la pacification peut être datée de 1897 : elle est marquée par la reddition du De Tham, le plus connu des chefs rebelles. Cette même année 1897 voit l'arrivée de Paul Doumer en tant que gouverneur général. La conquête a été réalisée par un corps expéditionnaire de trente-six mille hommes, décimé par la dysenterie et le choléra. Les troupes métropolitaines ont été rapatriées dès 1888 ; sur place sont restés les hommes de la Légion étrangère, des troupes de marine et des formations indigènes, essentiellement deux bataillons de tirailleurs annamites créés en 1884, et une milice. On estime qu'en 1895, les colonnes comportaient deux Indochinois pour un Européen.
Enfin, les décennies 1880 et 1890 voient les Français développer leurs positions à l'intérieur de la péninsule indochinoise. Le traité de protectorat sur le Cambodge, signé en 1884, réduit pratiquement le roi Norodom au rôle de roi fainéant, ce qui laisse les Français libres d'étendre leur domination sur les principautés laotiennes des bords du Mékong qui étaient jusque là l'objet de disputes entre Annam et Siam. L'action essentielle dans ces régions a été celle d'Auguste Pavie (1847-1925). Arrivé à Saigon comme sergent d'infanterie de marine en 1869, il est passé au service des Postes et Télégraphes de Cochinchine ; il pose les lignes télégraphiques et se passionne en même temps pour la civilisation khmère. Sa silhouette, pieds nus, un feutre sur la tête et le campot autour de la taille, devient vite célèbre. En novembre 1885, Pavie est nommé vice-consul de France à Luang Prabang, capitale du plus important des royaumes laotiens, et qui se trouve alors dans la dépendance du Siam. Tantôt seul, tantôt avec une escorte militaire, Pavie explore les régions qui se trouvent à l'ouest de la cordillère Annamitique, passe des traités avec les chefs indigènes, se trouve finalement chargé de délimiter la frontière entre Laos et Siam.
Ce tracé définitif des frontières dépend aussi d'un accord avec la Grande-Bretagne. Dès 1852, les Anglais occupent la basse Birmanie, et décident de placer très loin la ligne de protection de leur empire des Indes. Les frontières des possessions françaises sont fixées par l'accord avec le Siam du 3 octobre 1893, qui voit le royaume thaï renoncer à la rive gauche du Mékong, et conserver son indépendance grâce au rôle d'État tampon qu'il assume entre les territoires britanniques et français. Ces accords sont prolongés par ceux qui sont conclus avec la Chine en 1894, puis avec le Royaume Uni en 1896 et 1904. Le Laos, dans ses limites actuelles, se trouve constitué ; en 1907, le Siam restitue au Cambodge les provinces qui contiennent les ruines d'Angkor, capitale des Khmers entre les IXe et XIVe siècles. Enfin, la Chine cède à bail aux Français l'exploitation des mines dans ses trois provinces méridionales : Yunnan, Guangxi et Guangdong. Ce sont les ingénieurs français qui construisent la ligne de chemin de fer qui va de la frontière du Tonkin à Yunnanfu.
La mise en place de l'administration
Les premières tentatives d'administration ont été menées par le contre-amiral Bonard, dont la principale référence était la colonisation hollandaise de Java. Mais le succès n'est pas le même, car, à la différence de ce qui se passe alors en Indonésie, les mandarins vietnamiens ne forment pas véritablement une aristocratie. Ils restent fidèles à l'empereur, à qui ils doivent leur statut, par le biais des concours de recrutement, d'inspiration confucéenne. Cet état de choses explique leur large participation à l'insurrection de 1862-1863.
L'administration directe s'instaure véritablement avec le « gouvernement des amiraux » : les officiers de marine à qui est confiée la colonie jouissent d'une autorité quasi illimitée ; le gouverneur général se trouve assisté d'un conseil privé consultatif et de trois bureaux placés sous les ordres d'un directeur de l'Intérieur. La justice revient aux inspecteurs des Affaires indigènes. Ces dispositions font de la Cochinchine une colonie au plein sens du terme. Elle s'étend sur 60 000 km² en 1867, l'équivalent de neuf départements métropolitains.
La difficulté essentielle, au cours des années qui vont de 1860 à 1880, reste toutefois d'assurer l'ordre à l'intérieur de la nouvelle colonie, qui est loin d'être entièrement pacifiée. Un service militaire obligatoire de quatre ans permet de créer six bataillons annamites, qui peuvent renforcer sur le terrain l'action des milices locales. Un collège d'interprètes reçoit la mission d'enseigner le vietnamien et le français, et s'adresse d'abord aux militaires ; en même temps est mis sur pied le corps des lettrés-interprètes indigènes. Enfin, l'impôt repose sur l'établissement d'un cadastre et le recensement de la population.
Les grandes lignes de l'administration de l'Indochine se trouvent donc tracées lorsque Paul Doumer devient gouverneur ; les années de son « proconsulat » (1897-1902) constituent une étape importante dans l'organisation de la colonie, marquée par un regain de centralisation. Doumer développe l'œuvre commencée sous ses prédécesseurs, en particulier de Lanessan. Ses successeurs, Paul Beau (1902-1908), Klobukowski (1908-1911), Albert Sarraut (1911-1914), poursuivent l'œuvre entamée par Doumer, et dans la même optique générale.
Doumer élimine d'abord toute forme de contrôle de l'empereur d'Annam sur le Tonkin : dans chaque colonie ou protectorat, l'autorité passe au résident supérieur. Le jeune empereur Than Thai se trouve réduit à un rôle de figurant. En revanche, un contenu réel est donné à l'« Union indochinoise », qui comprend le Laos à partir de 1896, et Guangzhouwan (Kouang Tchéou Wan) après 1898. Au cours des années 1897 et 1898 sont mis en place les services généraux qui accompagnent l'infrastructure administrative d'un État du début du XXe siècle : le Secrétariat général, les directions du contrôle financier, des travaux publics, des douanes et Régies, de l'agriculture et du commerce, des P.T.T… La réforme la plus importante reste toutefois celle du Budget général, créé en 1899 et alimenté par les impôts indirects perçus dans l'ensemble de l'Union indochinoise. Les impôts directs restent, eux, à la disposition des budgets locaux. Au total, le gouverneur général contrôle l'ensemble des ressources des six territoires formant l'Indochine.
Politique et fiscalité
Sur le plan politique, le gouverneur général se voit déchargé des tâches administratives par les résidents supérieurs et le lieutenant-gouverneur de Cochinchine. En revanche, il est entouré par le Conseil supérieur consultatif, qui regroupe les hauts fonctionnaires, les représentants des grands intérêts financiers et industriels et deux notables annamites. Seule la Cochinchine a la possibilité d'élire un député et de maintenir quelques prérogatives d'ordre budgétaire ; en revanche, l'empire d'Annam n'a plus aucune possibilité d'autonomie politique. Du côté français, l'un des problèmes est de constituer un personnel administratif stable, qui soit intégré dans le corps des services civils créé en 1899. Dès le départ, le recrutement doit être rendu plus attractif par l'attribution de « traitements élevés ». L'ensemble du service, et même de tout le système administratif, est contrôlé par le gouverneur général, lui-même en correspondance régulière avec le gouvernement et les différents ministres. Les prérogatives obtenues par Doumer ont donc abouti à la mise en place d'une centralisation rigide, que Sarraut essaie d'assouplir à partir de 1911, en décentralisant un peu les services ; mais cela l'amène à multiplier les fonctionnaires, aux dépens du budget de l'Indochine : à Paris, la Chambre attaque régulièrement les « budgétivores ».
En effet, l'ensemble du système repose sur une lourde fiscalité, et au bout du compte sur le paysan indochinois. Les impôts directs s'élèvent au fil des ans, reposant, on l'a vu, sur le recensement. Mais la population que l'on estimait autour de vingt millions d'habitants en 1897 se situe en fait à dix-neuf millions au recensement de 1921, plus de vingt ans après. La surévaluation du nombre des contribuables accroît la part à verser par chacun d'eux entre 1900 et 1920. La fiscalité la plus lourde semble par ailleurs avoir été la fiscalité indirecte : la plupart des revenus proviennent des douanes, ainsi que des « trois régies », du sel (1897), de l'opium (1899), et de l'alcool de riz (1902). Ce système des régies, attaqué par certains contemporains comme le colonel Bernard, contribue à générer l'inflation et à dégrader la santé publique. Toutefois, la fiscalité est si lourde qu'après 1900 l'Indochine cesse de peser sur le budget national ; des excédents commencent même à se dégager si bien qu'il est possible à partir de 1898 d'émettre sur le marché français des emprunts de chemins de fer et de travaux publics. Ces emprunts sont gagés sur le budget indochinois.
Le programme économique
L'équipement colonial s'appuie sur un ambitieux programme. L'axe essentiel en est la mise en place d'un réseau ferroviaire indochinois, reposant sur trois lignes : celle du Yunnan, celle du Guangxi, de Dong dang à Langzhou, et celle du Siam, de Saigon à Battembang. La construction d'un réseau ferroviaire dans la partie méridionale de la Chine, affaiblie par le traité de Shimonoseki (1895), aiguise les appétits financiers : la colonisation française en Indochine se trouve relayée par une aire d'influence en Chine. À la fin de la décennie 1890, trois missions d'origine différente soulignent l'intérêt de la mise en place d'un bon réseau ferroviaire. Une mission d'exploration commerciale en Chine est constituée en 1895 par Ulysse Pila, président de la Compagnie lyonnaise d'Indochine. Son envoyé, Henri Brenier, souligne en 1897 le faible volume du commerce entre Tonkin et Yunnan, ainsi que l'importance des mines chinoises de Mongzi. En 1895 également, le Comité des Forges a institué une Société d'études industrielles en Chine, afin d'y vendre du matériel. Son envoyé, Dujardin-Beaumetz, insiste dans son rapport de 1897 sur les richesses du Yunnan en étain, cuivre et argent, ainsi que sur l'intérêt que présenterait une installation permanente. Une troisième mission, Guillemoto-Leclerc-Bélard, a pour but de fournir aux responsables politiques français les aspects techniques qui leur font défaut. Tout cela aboutit aux conventions franco-chinoises, signées en 1895 et 1898, et à un budget total d'un montant de soixante-dix millions de francs. Un système d'emprunts, gagés sur le budget de la colonie, doit permettre d'assurer ce financement.
Sur ces bases se met en place, en 1898, un consortium regroupant financiers et industriels : toutes les grandes banques parisiennes s'y trouvent représentées, sous la direction de la Banque d'Indochine ; aux banques s'ajoutent deux importantes sociétés de travaux publics et de transports, la Société des Batignolles et la Régie générale des chemins de fer. Les représentants du consortium rédigent le texte fondateur le 11 novembre 1898, en présence de Paul Doumer. Ils demandent une subvention annuelle de trois millions de francs, ce qui est approuvé par la Chambre et le Sénat. Sur place, l'ingénieur Guibert obtient la concession de la ligne Haïphong-Laokay.
Les années qui suivent voient un dépassement du budget prévu initialement, qui de 70 millions passe vite à 100 millions. Une subvention de 12,5 millions de francs est accordée au consortium, à partir d'un prélèvement sur le budget de la colonie ; le consortium obtient ensuite la concession de la ligne Hanoi-Haïphong, puis l'exploitation pour soixante-quinze ans de Hanoï-Laokay, ce qui inclut la fourniture du matériel roulant. Fondée en 1901, la Compagnie du chemin de fer de l'Indochine et du Yunnan est une émanation du consortium. Finalement, le consortium a besoin de 65 millions de francs supplémentaires pour achever la ligne du Yunnan, c'est-à-dire 465 km de voie ferrée et trois cents ouvrages d'art.
Dans l'ensemble, le bilan des placements français en Indochine se monte, en 1914, à 16% des capitaux absorbés par l'empire colonial ; les investissements privés correspondent à 230 millions, les investissements publics à 426 millions. Sur les fonds publics consacrés à l'équipement, les chemins de fer représentent 380 millions, pour 1900 km de voie étroite, ligne du Yunnan comprise. Autre grande réalisation, le Transindochinois n'est pas terminé à la veille de la première guerre mondiale. D'autres grandes réalisations, en revanche, se terminent : le pont Doumer, l'équipement des principaux ports, Haïphong, Tourane et Saigon. De nombreux capitaux lyonnais se sont investis dans la Compagnie lyonnaise de l'Indochine (1898), dans la Cotonnière de l'Indochine (1898). La Banque de l'Indochine crée une Société des charbonnages du Tonkin en 1899, la Société des Batignolles une Société des ciments Portland de l'Indochine (1899). La prospérité de la Banque de l'Indochine apparaît liée bien sûr au développement des affaires indochinoises, mais aussi au développement d'autres régions d'Asie. Le capital de la banque, 24 millions de francs en 1900, a doublé en 1910 pour atteindre 48 millions. La banque possède un monopole de fait dans les colonies d'Asie, avec privilège de l'émission des billets. Elle prête aux sociétés pour financer des travaux publics, et ouvre des succursales au Tonkin, en Annam, au Cambodge, mais aussi en Nouvelle-Calédonie, en Chine, au Siam. Ses opérations proprement coloniales ne représentent que 37% de son chiffre d'affaires ; le reste est réalisé par des opérations en Chine, en Inde ou même à Paris.
Toutefois, le bilan global du commerce extérieur laisse apparaître une grande faiblesse des investissements industriels. Aux importations, l'Indochine reçoit des produits finis de consommation, essentiellement des cotonnades, pour 70%, en 1913. Avec l'Algérie, elle est le principal client de l'industrie cotonnière métropolitaine. Aux exportations, 66% sont représentés par le riz ; la houille ne représente que 2%, le latex 1%, les métaux non-ferreux 1% également. L'Indochine n'avait guère l'impression de profiter de l'important effort fiscal consenti depuis les débuts de la colonisation : ce sentiment de frustration contribue à expliquer les difficultés auxquelles se trouvent confrontés les successeurs de Doumer.
Les difficultés sociales et politiques entre les deux guerres
Dès les premières années du XXe siècle, un mouvement national important commence à se former. Le mécontentement a plusieurs origines ; les colonisateurs ont tendance à faire une distinction entre la Cochinchine, et en particulier la région de Saigon, où commence à se développer une bourgeoisie vietnamienne, et le Tonkin, qui apparaît beaucoup plus comme un réservoir de main-d'œuvre. D'autre part, la pression fiscale se fait de plus en plus forte, et s'ajoute pour les paysans aux méfaits traditionnels de l'usure, mal répandu dans toute l'Asie du Sud-Est mais que la colonisation française n'a pas fait disparaître. Enfin, les lettrés, cadres traditionnels de la société vietnamienne, se trouvent écartés de l'administration de leur pays au profit d'un corps de fonctionnaires étrangers, et en ressentent une permanente frustration. De nouvelles catégories sociales, les « lettrés-fonctionnaires » ou « lettrés-commerçants », sont le produit d'une certaine assimilation de la culture française ; dans le but de faciliter le développement de l'éducation, Paul Beau crée de nombreuses écoles et favorise la réforme de l'alphabet romanisé vietnamien, le quôc ngu crée par Alexandre de Rhodes au XVIIe siècle, et légèrement revu par Pigneaux de Behaine à la fin du XVIIIe. Ces réformes permettent effectivement l'apparition de nouvelles catégories, qui ont assimilé les apports européens. Toutefois, ces nouveaux statuts n'éliminent pas les frustrations, car ces intellectuels partagés entre deux cultures ne dépassent que rarement les échelons subalternes de la bureaucratie française. En 1910, le député Messirny, dans Notre Œuvre coloniale, parle de « l'hostilité sourde mais grandissante que nos sujets nous témoignent de plus en plus ».
Autour de 1910, les modèles des jeunes générations de Vietnamiens sont de trois types : les philosophes français du XVIIIe siècle, d'abord, modèle puisé chez le colonisateur lui-même ; puis le Japon de l'ère Meiji et le Guomingdang de Sun Wen (Sun Yat-Sen). Ces idées, essentiellement réformistes, sont à la base de deux mouvements : celui de Phan Châu Trinh, qui s'adresse directement à Paul Beau à travers un mémoire dans lequel il dénonce les méfaits du régime colonial. Ces idées sont diffusées par l'Institut du Tonkin, à Hanoi, qui est fermé par décision du gouverneur en décembre 1907. Le mouvement « Exode vers l'Est », de Phan Bôi Châu, est plus révolutionnaire : pourchassé par la police, Phan s'installe au Japon, suivi par l'un des jeunes princes et une centaine d'étudiants. Le mouvement est animé ensuite par des sociétés secrètes et parfois commerciales, surtout en Cochinchine. Il est démantelé lors de l'arrestation de Gilbert Chieu, en 1908.
L'année 1908 est marquée par trois événements importants : en mai et juin, la partie centrale de l'Annam est le théâtre de manifestations pour la diminution des impôts et la suppression des corvées. En juin a lieu une tentative d'empoisonnement de la garnison de Hanoi. Enfin, en juillet, le Dê Tham réapparaît près de Hanoi. Contre ces diverses atteintes à la colonisation, le gouvernement utilise l'arsenal policier mis en place par de Lanessan. Une juridiction d'exception, la Commission criminelle du Tonkin, prend en mains l'affaire de l'empoisonnement, qui a des ramifications au sein des divers mouvements anti-coloniaux ; elle prononce treize condamnations à mort. En Annam, de nombreux lettrés qui ont participé aux manifestations sont condamnés. Phan Châu Trinh est lui-même condamné à mort. Sur une intervention de Pressensé à la Chambre, sa peine est commuée en travaux forcés, et il est envoyé au bagne de l'île de Poulo-Condor. Il sera libéré en 1911 grâce à l'action de la Ligue des droits de l'homme. Enfin, les bandes du Dê Tham sont poursuivies par la colonne mobile du colonel Bataille, jusqu'à l'exécution du vieux chef rebelle, en 1913.
C'est désormais à partir de Canton que le mouvement de Phan Bôi Châu essaie de lancer des actions terroristes sur l'Indochine. Elles semblent sans grande efficacité, comme l'attentat contre Albert Sarraut, qui échoue en décembre 1912. Les nationalistes recherchent désormais de nouvelles voies : les premiers rapports entre révolutionnaires vietnamiens et socialistes européens se nouent à la veille de 1914, où apparaît pour la première fois le nom de Nguyên Aï Quoc, le futur Hô Chi Minh. Nguyên Aï Quoc est né en 1890, dans la province du Nghê An, au sud du Tonkin. Installé en France, il est acquis aux idées socialistes, puis s'inscrit au parti communiste après le Congrès de Tours, en 1921. Au Tonkin, les intellectuels annamites, qui ont pour la plupart reçu un enseignement français, se sont regroupés dans le Parti national du Viêt Nam. Une tentative de soulèvement du Tonkin échoue à Yên Bai le 10 février 1930. Le Parti national est démantelé lors de la répression et cède désormais la place au Parti communiste indochinois fondé cette même année par Nguyên Aï Quoc, désormais appelé Hô Chi Minh, « Qui apporte les lumières ».
Par rapport à ces difficultés, le gouvernement colonial tente quelques réformes. Ainsi, la création d'une université indochinoise a pour but de freiner l'exode des jeunes Vietnamiens vers le Japon. Toutefois, de nombreux étudiants y deviennent d'ardents défenseurs du Mouvement national, et Klobukowski préfère fermer cette université. Paul Beau a également essayé de doter le Tonkin de plusieurs organismes consultatifs : conseils de province et Chambre du Tonkin, avec élections au suffrage restreint. Même s'ils n'ont pas de pouvoir réel, ces nouveaux élus ne s'en joignent pas moins au mouvement de protestation antifiscale de 1908. Klobukowski supprime ces conseils, que Sarraut rétablit. La politique assez souple d'Albert Sarraut (1911-1919) et l'essor économique des années 1920, après le premier conflit mondial, expliquent un certain apaisement. Les grands chantiers se poursuivent : le Transindochinois par exemple, de Saigon à Lao Kay sur la frontière chinoise, passant par Hué et Hanoi et long de 1135 km, est achevé en 1936. Lorsqu'éclate la seconde guerre mondiale, le calme règne pratiquement dans toute l'Indochine. Les conséquences du conflit allaient perturber ce fragile équilibre.
La seconde guerre mondiale
La défaite française de 1940 laisse l'Indochine dans un grand désarroi, et pratiquement à la merci des Japonais qui reprochent à la France d'acheminer du matériel militaire vers la Chine par le Transindochinois. Le Japon adresse un ultimatum au général Catroux, alors gouverneur général, le 19 juin 1940. Catroux accepte de fermer la frontière dès le lendemain mais il demande des renforts à la métropole, ainsi qu'un appui à la Grande-Bretagne et aux États-Unis. Cela lui vaut d'être révoqué par le gouvernement de Vichy, qui le remplace par l'amiral Decoux.
Decoux, qui ne dispose que de faibles troupes et de matériel désuet, se voit contraint à accepter les exigences des Japonais, notamment l'occupation de la base navale d'Haïphong, en septembre 1940. En même temps, le Siam profite de l'occasion pour attaquer les Français ; il subit toutefois une défaite navale à Koh Chang, en 1941. Malgré tout, les Japonais réussissent à obtenir pour lui la cession des provinces laotiennes de la rive droite du Mékong ainsi que la province cambodgienne de Battambang, où se trouvent les ruines d'Angkor, lors de la convention de Tokyo le 9 mai 1941. La présence de ses troupes en Indochine permet au Japon d'y implanter un réseau d'espionnage dense et efficace, qui développe les sentiments anti-français. Lorsque la situation semble mûre, les Japonais portent un ultime coup au prestige déjà bien ébranlé de la France en occupant toute l'Indochine par le coup de force du 9 mars 1945. De ce fait, ils préviennent aussi toute forme de ralliement aux Alliés.
Le 10 mars 1945, ce sont les Japonais eux-mêmes qui prennent l'initiative de proclamer l'indépendance du Viêt-Nam. À leurs côtés, l'empereur Bao Dai, né en 1913, est devenu empereur d'Annam en 1925, à la mort de son père Khaï Dinh. Après avoir fait des études en France, il ne monte réellement sur le trône qu'en 1932 et laisse fonctionner l'administration directe de la France en dépit de son ministre Ngô Dinh Diem, qui préfère se retirer dès 1933. Sa popularité des premiers temps décline au fur et à mesure que l'on prend conscience de sa passivité, devant les Français comme devant les Japonais. À la demande de Hô Chi Minh, il accepte d'abdiquer le 25 août 1945, après la proclamation d'indépendance.
La fin de l'Indochine française
Le départ des Japonais voit culminer le mouvement indépendantiste. Le 29 août 1945, Hô Chi Minh proclame la République Démocratique du Viêt-Nam, sous le contrôle du Viêt Minh, fondé en 1941 par Hô Chi Minh et regroupant nationalistes et communistes. Bao Daï entre dans le cabinet de Hô Chi Minh au titre de « Conseiller suprême » tandis que ce dernier devient président de la République le 2 mars 1946 ; son gouvernement s'installe à Hanoi, et il signe avec Sainteny, représentant de d'Argenlieu, les accords de mars 1946. En effet, une ambiguïté de taille subsiste : le 16 août 1945, le gouvernement de Gaulle a nommé l'amiral d'Argenlieu Haut-Commissaire pour l'Indochine, avec mission de « rétablir la souveraineté française ». Un certain nombre d'opérations ont eu lieu : le Viêt Minh a déclenché un soulèvement à Hanoi en août 1945, les Français ont repris Saigon le 23 septembre. Après son élection au titre de président de la République, Hô Chi Minh accepte que le Viêt-Nam fasse partie de la Fédération indochinoise et de l'Union française (6 mars 1946) ; mais les négociations qui se tiennent à Fontainebleau de juillet à septembre 1946 échouent sur la question de la Cochinchine, réclamée par le Viêt-Nam.
Cet échec est à l'origine d'une reprise des activités militaires entre la France et l'Indochine, au lendemain de la seconde guerre mondiale. La flotte française bombarde Haïphong le 24 novembre 1946, puis le Viêt Minh organise des représailles à Hanoi le 19 décembre ; ces opérations sont à l'origine d'un vaste embrasement, qui commence avec l'apparition de foyers de guérilla dans le haut pays, c'est-à-dire dans les zones contrôlées par le Viet Minh et ses alliés indochinois : Pathet Lao, Issarak du Cambodge. Les foyers s'étendent progressivement, tandis que la France négocie avec le Siam pour obtenir la restitution des provinces perdues en 1941.
Une série d'événements accélère toutefois l'issue diplomatique du conflit. C'est d'abord l'intervention de Bao Dai, qui revient sur son abdication de 1945. Après s'être retiré à Hong Kong, il demande à la France, qui le soutient, de reconnaître l'indépendance du Viêt-Nam, ce qui est fait le 8 mars 1949. Bao Dai reprend alors son titre impérial, et forme à Saigon un gouvernement provisoire. Au terme d'un échange de lettres avec le président Vincent Auriol, il accepte de faire du Viêt-Nam un « État associé à la France ». Mais à cette date, les troupes chinoises communistes de Mao Zedong progressent vers le sud, et atteignent la frontière sino-vietnamienne au mois de décembre 1949.
Les opérations militaires n'en durent pas moins de longues années encore : en 1953, les trois « États associés » d'Indochine – Cambodge, Laos et Viêt-Nam – forment trois hauts-commissariats, regroupés en un commissariat général. C'est toutefois la capitulation de Diên Biên Phu, le 7 mai 1954, qui accélère les négociations ouvertes à Genève depuis le 26 avril. L'accord du 21 juillet 1954 reconnaît la neutralité du Laos et du Cambodge, tandis qu'il partage provisoirement le Viêt-Nam en deux États, du Nord et du Sud. La France évacue ses troupes, qui se retirent définitivement de Hanoi le 13 mai 1955, et de Saigon le 10 avril 1956. Réfugié en France, Bao Dai se voit écarté du trône à partir de 1955.
L'Indochine française a duré moins d'un siècle, et son histoire s'achève au début des années 1950 dans un contexte de guerre idéologique. Les deux guerres mondiales, au cours du XXe siècle, ont contribué à rendre difficile la mise en place d'un équilibre entre l'administration française, sans doute trop directe, et les pouvoirs locaux traditionnels que ne coordonne pas vraiment l'action de souverains à la personnalité souvent faible ou incertaine. Une pression fiscale trop importante n'a fait que renforcer l'endettement, déjà chronique, de la paysannerie ; elle a toutefois contribué à rendre possibles certains aspects de l'équipement, en particulier sur le plan ferroviaire. Enfin, sur le plan culturel, c'est l'aventure coloniale qui a permis la découverte des civilisations de l'ancien Cambodge et du Dai-Viêt aux alentours de 1880.
Jean-Pierre DuteilAvril 2003Copyright Clio 2016 - Tous droits réservéshttp://www.clio.fr/bibliotheque/les_francais_en_indochine_des_annees_1830_a_la_fin_de_la_deuxieme_guerre_mondiale.aspBibliographie
Histoire de l’Indochine
Philippe Heduy
Albin Michel, Paris, 1998
Les Français en Indochine, 1860-1910
Charles Meyer
Hachette-Firmin Didot, Paris, 1996
La société vietnamienne face à la modernité. Le Tonkin de la fin du XIXe siècle à la fin de la seconde guerre mondiale
Nguyen Van Ky
l’Harmattan, Paris, 1995 Suivre le flux RSS des articles
Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires
Suivre le flux RSS des commentaires